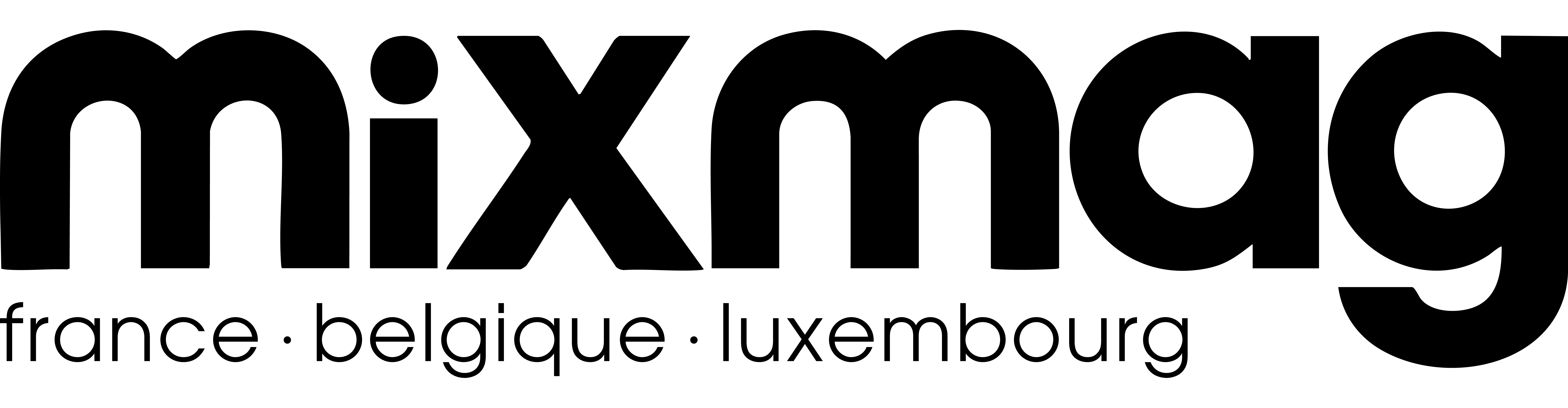Mag
Mag
La Fraîcheur : place à la techno furieuse, mordante et citoyenne
Ce que la musique électronique a de plus électrisant en 2019
Peu d’artistes électroniques ont eu l’honneur de passer plusieurs jours dans les studios d’Underground Resistance en compagnie de Mike Banks pour enregistrer un album. Et pourtant, à voir l’humanité et la bienveillance de La Fraîcheur, artiste aux cheveux courts et au regard pétillant, on décèle ce qui lui a permis de conquérir les légendes techno de Detroit : une passion sans faille, un attachement indéfectible à la portée sociale de l’expérience collective du son – celle qu’on retrouve dans la dévotion de Mike Banks à sa communauté. En dépit des obstacles de ses années passées dans les engrenages de l'industrie musicale, La Fraîcheur a toujours tracé sa route, quel que soit le goût du jour. Ce faisant, elle est devenue un phénomène à part entière.
Mais la réussite ne plaît pas toujours à tout le monde, en particulier quand on sort des sentiers battus : après la sortie de son LP Self-Fulfilling Prophecy sur InFiné l’an passé, Perrine Sauviat de son vrai nom a dû faire face à un torrent quotidien d’attaques misogynes et homophobes. C’est de sa rage qu’est né son nouvel EP Weltschmerz : « la souffrance du monde », un terme employé par l’auteur allemand Jean Paul pour décrire le sentiment qu’on éprouve quand le réel ne satisfait pas les aspirations de l’esprit. Un voyage entre la résignation des titres évocateurs ‘Quicksand’, A Fucking Opportunity For Growth’ et la combativité retrouvée du brûlant ‘Misanthropy’ et du beat martial de ’Weltschmerz’, c’est sans aucun doute sa sortie la plus violente, nuancée et déterminée, orchestrée avec la finesse qu’on lui connaît – tant en DJ set que dans le studio.
Dans un bar berlinois du quartier arty de Neukolln, quelques jours avant son passage au Made Festival le 24 mai, nous avons rencontré l’artiste installée depuis 8 ans dans la capitale allemande. L’occasion d’évoquer sa vision sans compromis de la portée de la techno, un genre dont les rythmes poussent à la fête autant qu’à la résistance.

Tu as vécu à Paris un moment... Qu’est-ce qui t’a motivée à partir ?
C’était un burn out complet. J’avais monté mon agence de promotion et je m’occupais de groupes de rock indé, de punk, d’électro pop. Des années passées à bouffer des pâtes midi et soir, avoir deux téléphones et à croire que tu peux avoir une vie privée à côté de ta vie professionnelle... Ça faisait déjà presque dix ans que j’habitais à Paris, j’en avais marre du stress et de l’agressivité ambiante, cumulé à des ruptures amoureuses. J’ai fait un raz-le-bol complet de Paris et tout ce qui était associé et je me suis cassée. C’était un besoin d’une nouvelle étape, de recommencer autrement.
Ensuite à Montréal, je bossais une fois par semaine et le reste du temps je faisais du dessin, de la peinture, un peu de musique... Je menais une vie un peu décroissante. Ça a été le début de la phase hippie de ma vie.
Est-ce que tu as pu faire l’expérience de la scène locale à Montréal ?
En l’occurrence la scène locale à Montréal qui me plaisait et celle qui me manque aujourd’hui, c’était plus la scène indie rock, art rock, punk, plutôt que la scène électronique que je côtoyais peu à l’époque. Et puis on parle d’il y a plus de dix ans, tout ce qui était les Mutek ou Igloofest n’avaient pas le même poids qu'aujourd’hui. Pour moi ce qui était important, c’était plutôt d’être dans une ville où à deux/trois blocs de chez moi tous les soirs de la semaine je pouvais aller à un concert de rock quelque part.
Avant d’être attachée de presse de groupe, j’étais aussi productrice de concert à Mains d’œuvres, programmatrice de concert avec Guido d’Acid Arab dans un bar qui s’appelait le 9 Billards. Et pouvoir aller à un concert sans me dire « qui est leur label ? qui est leur manager ? » et juste pouvoir profiter, c’était cool.

Ça fait huit ans que tu es installée à Berlin, c'est une grosse page de ta vie...
Berlin a eu un impact dans plein d’aspects de ma vie. Mais en tout cas ça a bien relancé mon envie de mixer. Je pensais avoir fait le tour avec mon expérience parisienne, montréalaise et puis toutes les tournées que j’avais faites entre temps et j’avais perdu un peu la flamme. Toutes les années avant, j’étais DJ pour le plaisir de partager la musique qui me plaisait mais je n’avais jamais été une danseuse ou une habituée des clubs, ce n’était pas un environnement dans lequel je me sentais à l’aise. Donc me mettre à danser à Berlin, ça a complètement switché la vision de mon travail, en me disant “ah mais c’est ça que les gens ressentent quand je joue en fait !”. Ça a vraiment relancé ma motivation pour mixer. Et ça a fait naître ma motivation pour produire.
De me retrouver à Berlin, ça a aussi renforcé mon attitude vis-à-vis de mon identité. Il y a plein de pays dans le monde où la communauté queer est un safe space dans lequel tu peux te réfugier. Ici, ce n’est pas juste un truc alternatif, c’est un moteur culturel. Si on parle des soirées dans lesquelles j’ai joué et les familles dont je fais partie, que ce soit les Gegen, Buttons (avant Homopatik) et House of Red Doors, c’est pas juste un moment qu’on te donne pour respirer parce que le monde dehors n’est pas cool pour toi. On crée une musique, une esthétique, des performances. J’ai toujours été à l’aise avec mon identité et ma sexualité, mais pour moi c’était séparé de mon travail. Et tout d’un coup, de réaliser que toute notre identité est politique, glorifions-nous et glorifions-la là dedans ! Que ce soit relancer mon amour du DJing à travers la danse, lancer mon envie de produire, et me conforter dans mon identité, c’est à ces niveaux-là que l’impact de Berlin a été le plus important.

Quelles sont les fragilités de la scène berlinoise ?
Je pense qu’il y a plusieurs choses. Premièrement, l’évolution naturelle de l’histoire qui fait qu'aujourd'hui la scène musicale de Berlin a eu besoin de s’organiser et se professionnaliser parce que la ville s’est restaurée, réorganisée. Dans un Berlin post-chute du mur où tu n’avais pas assez de moyen pour les flics, où Berlin Est était un terrain de jeu laissé à l’abandon par les institutions... il n'est plus laissé à l’abandon aujourd’hui, il faut payer un loyer, la police vient vérifier que les gens soient payés légalement et pas au noir, etc. Ça a poussé la scène à se professionnaliser ce qui est une bonne chose, mais ce qui limite aussi la liberté créative que tu as en tant que club, parce que les clubs ont besoin de faire rentrer les gens pour payer leur loyer, leurs employés. Il y a dix ans, tu pouvais programmer qui tu voulais, quand tu voulais, tu n’avais pas besoin de headliners, on s’en foutait de qui jouait. Je sens aujourd’hui une uniformisation, moins de prise de risques, mais que je comprends encore une fois, pour des raisons systémiques et d’organisation de la société et de la politique de la ville.
Je pense que Berlin est aussi en train de souffrir de son mythe. La ville a trouvé une formule et une fois qu’elle est reproduite elle n’est plus intéressante. Je suis contente que ça a un impact. J’ai hâte de voir dans dix ans quand la ville aura été forcée à renouveler sa formule. Mais le Berlin d’aujourd’hui est un peu plan-plan dans ses codes.
Et il y a une solidarité dans le clubbing, en tant que danseur, qui me manque et qu’on a perdue je pense. J’ai des problèmes de dos et il y a cinq-huit ans, il y avait toujours quelqu’un pour venir me voir et me demander si ça va. “Tu fais un bad trip ? Tu as besoin de quelque chose ?” Je répondais “Non, non, ça va, j’ai juste mal au dos”. On me répondait “Tu veux un massage ? Un ibuprofène ?” Les gens prenaient soin des autres, au sein du club, on était une famille. Ce changement-là, ce truc qui était vraiment familial et communautaire au sens d’individus humains qui se retrouvent dans un même espace pour s’oublier et pour se soutenir, je ne le trouve plus aujourd’hui. Pour moi, c’était un des éléments les plus chaleureux et des plus influents de Berlin, et ça me rend un peu triste que cette solidarité se perde. [...]

En tant que Française, tu gardes certainement un œil sur la scène locale. Qu’est-ce que tu penses de ce qui s’est passé ces cinq dernières années à Paris ?
Ça m’a fait super plaisir de voir que Paris a compris qu’elle n’était pas obligée de s’enfermer dans cette zone géographique du périph’. Et moi qui ai bossé à Mains d’Oeuvres pendant des années, à produire des concerts où on galérait à ramener du monde, de voir qu’il y a des soirées à Asnières, à Clichy et ailleurs, ça me fait plaisir... de voir du renouveau. Les formats deux jours, les fêtes de jours le dimanche après-midi, c’est clairement berlinois. Mais pour moi ce qui est intéressant, ce n’est pas que ce soit berlinois, c’est que ce soit une formule qui a été récupérée pour faire revivre Paris. C’est plus la dynamique qui me fait plaisir !
Tu envisages d’y revenir un jour ?
Je pars à Barcelone à la fin du mois de juin. Et après Barcelone, on en reparle. Peut-être que j’aurai envie de revenir à ce moment-là (rires). Mais non, je n’ai pas particulièrement envie de rentrer à Paris. Je pense que je me suis habituée à la qualité de vie à Berlin. Quand je vois pleins d’amis qui partagent des studios, ils font pas autant de musique qu’ils voudraient. Je ne suis plus fâchée avec Paris, mais je ne me vois plus du tout y habiter.
Moi je suis arrivée à Paris quand j’avais 18 ans, avec les yeux qui pétillent, la gamine qui sort de sa ville de province. Mais quand tu passes toute ta vie à bosser comme un chien ou comme une chienne pour pouvoir à peine te payer un studio de 12 m², je comprends qu’on soit tous vénères. Structurellement l’économie et l’urbanisme de Paris fait que c’est difficile d’être léger. Et je pense qu’il faut un peu de légèreté pour faire de la musique.
La leçon que tu as retenue des soirées Queer ?
J’ai retenu que bizarrement, être à poil peut être un événement complètement désexualisé. Le nombre de fois où j’ai joué à la Gegen avec des mecs qui se masturbaient à deux mètres de moi, je ne les compte plus maintenant ! Alors même que tu es dans un espace sex positive ou supposément focus sur le sexe, c’est en fait l’endroit où je suis le moins sexualisée du monde et où je peux mixer en soutif et pas me faire emmerder. Mais ça, je pense que ce n’est pas seulement lié à la scène queer mais aussi à l’influence de l’Allemagne de l’Est où la nudité n’était pas sexualisée. Et de réaliser que c’était dans les soirées Queer que j’étais la moins sexualisée, ça te permet de voir les choses différemment et d’être vachement plus libre. Par exemple moi je danse beaucoup quand je mixe ce qui fait que j’ai vite très très chaud. Et plusieurs fois [en France, ndlr], j’ai dû me retenir d’enlever mon t-shirt parce que ça allait me poser des problèmes. C’était vraiment la liberté de faire ce que tu veux, et ça c’était très émancipateur.

Tu sors un nouvel EP : comment tu décris l’évolution entre ton précédent album et ce nouveau projet ?
Plein de choses ! L’album c’est fait pour explorer les différentes facettes de ta personnalité et d’aller un peu plus loin que le club et la tyrannie du dancefloor et de l’efficacité. J’ai pris le temps de me réconcilier avec toutes les choses que j’aimais pour les mettre dans un même travail.
Mais après la sortie, j’ai réalisé que je jouais dans mes sets très peu des mes propres morceaux. Je joue ‘The Movement’, et j’avais envie de produire quelque chose qui était plus proche de ce je jouais. Ces dernières années, mes sets techno se sont durcis, plus rapides, distordus, plus rapprochés du hardstyle et du hardcore des années 1990. En diggant des vinyles en tournée, j’ai trouvé énormément de trucs hardcore, borderline trance italiens des années 90 que plus personne ne veut écouter. Moi ça m’a parlé et je me suis mise à mixer ça. C’était l’énergie du moment. [...] C’est aussi lié à ma visibilité accrue après l’album qui a fait que je me suis vite retrouvée victime de harcèlement par des trolls. Et apparemment ça pose problème, parce que j’ai commencé à recevoir des feedbacks de médias qui m’ont dit « ça serait bien de parler de musique et pas de société ».
Mon album était lié à la perte d’un membre de ma famille. Et tout d’un coup le deuil est quelque chose de légitime, un sentiment qui serait à l’origine d’une œuvre créative. Mais quand c’est le sexisme, ça pose problème parce que « on en a déjà parlé, on aimerait bien passer à autre chose. » Sauf qu'il se trouve que cet EP-là est né du besoin d’expulser. Quand tu regardes ton Instagram et que tout ce que tu vois c’est des insultes, des menaces, tu te dis « ok, ça m’a bouffée ma matinée, je vais me vénère sur mes synthés, scratcher un peu des sons bruts, et puis je vais pouvoir respirer. »
Ce qui m’a marquée dans ton son, c’est l’utilisation des voix et des samples qui me rappelle le son des frees, où on retrouve aussi cette utilisation très politique de discours, de dialogues de films.
Mon utilisation des samples vient plus de certaines productions de musique électronique où il y avait l’utilisation de long samples politiques qui pointent du doigt des questions sociologiques ou anthropologiques qui me semblaient intéressantes. Et puis c’est aussi le rap et le hip hop. Là je suis en train de faire mes cartons pour aller à Barcelone, et je viens de retrouver un CD que j’avais oublié mais qui était formateur, c’était la compilation 11'30 Contre les Lois Racistes. La compilation où tous les rappeurs français avaient chacun un couplet. Pour moi, ça me semblait évident d’utiliser les samples. Et ça vient plus de là que du hardcore pour moi. En l’occurrence, à l’époque je ne sortais pas dans les raves hardcore, je jouais dans ma chambre d’étudiante. Je suis tombée sur les vinyles et je les ai joués chez moi.
La Fraîcheur sera de passage le 24 mai à Rennes au 1988 Live Club dans le cadre du Made Festival, aux côtés de Roman Flugel et Jabba 2.3 pour notre série Electronic Subculture. Sa performance sera enregistrée et retransmise en différé sur notre page Facebook.
Propos recueillis par Marie Dapoigny.