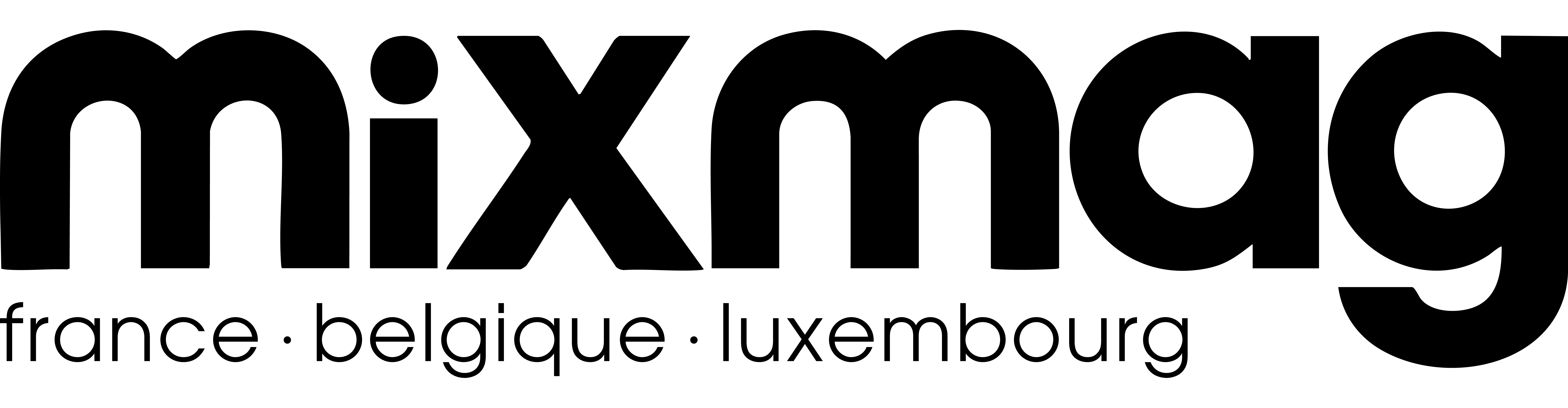Blog
Blog
Keep Shelly in Athens : « C’est dur de décider de rester ici »
En Grèce, le pays de la crise économique, le futur des artistes est incertain.
Keep Shelly in Athens, dont le nom provient d’un jeu de mot sur le quartier de Kispseli, est sûrement la formation électronique le plus célèbre hors de Grèce. Malgré tout, vivre dans le pays symbole des crises économiques en Europe n’est pas chose aisée. Alors qu’un sixième album sortira à la rentrée, le fondateur du groupe, Notis et la chanteuse Jessica Bell discutent de la situation économique du pays et de leur quartier favori, au nord de la capitale grecque, entre deux gorgées de café glacé.

C’est devant Goody’s, fast food bien connu sur Fokionos Negri Street que Jessica Bell donne rendez-vous. Collier et haut gris, cardigan aussi noir que sa frange, la nouvelle chanteuse du groupe, née à Melbourne, rattachée à la Grèce par son beau-père, n’a pas choisi le lieu pour s’envoyer un burger. Cette rue au cœur de Kypseli, quartier à 25 minutes et 7 euros de taxi du centre-ville, a celle qui a inspiré à Notis l’un des ses plus beau titres. Fokiona Negri fut également un homme politique et ancien président de l’Académie d’Athènes, qui donna son nom à cette artère cosmopolite, autrefois bourgeoise, désormais bien plus populaire. En terrasse du Select Café, un bar aux stores blanc cassé sponsorisés par Heineken, le leader mal rasé en hoodie noir enchaine les sujets dans un Anglais décent, soutenu par Jessica lorsqu’il cherche chez mots. D’entrée, il assure préférer parler musique que politique. Mais à la simple évocation de Syriza, parti de gauche radicale au pouvoir depuis 2015, il part au quart de tour. S’il était enthousiaste il y a deux ans, il promets être aujourd’hui plus neutre…
Pourquoi te dis-tu plus neutre qu’il y a deux ans sur le sujet ?
Notis : Parce qu’on ne décide pas. C’est le facteur clef. Le gouvernement ne peut décider de rien. La ligne principale vient de l’Union Européenne. Ils essaient de gérer la situation au mieux. Je ne sais pas si c’est comme ça que tous les Athéniens pensent, mais dans mon entourage, oui. Quand tu dois gérer la même situation pendant des années, tu ne peux pas faire de réelle différence. Ils ont quand même essayé d’aider les plus défavorisés, au niveau le chômage.
L’un des points négatifs est qu’avant l’élection, ils disaient pouvoir tout changer presque tout de suite. Le premier ministre n’avait pas à mentir à ce point. C’était juste pour se faire élire. Il dit représenter une nouvelle génération d’hommes politiques. Mais ça, c’est des pratiques à l’ancienne. Je comprends que tu sois en campagne, mais tu peux faire mieux que ça. Dis que tu peux aider les plus faibles, ça suffit. C’est des mensonges inutiles. Donc je ne sais pas si je revoterai pour eux. La crise a démarré il y a longtemps et les gens sont de moins en moins optimistes.
C’est vrai qu’on pense que les choses ne vont être pas chères à Athènes. Mais ce n’est pas vraiment le cas…
Jessica : Non. Le yoghourt grec est moins cher en Allemagne qu’ici.
N : Et ce n’est pas la seule chose absurde qui se déroule en ce moment. Les taxes sont trop élevées. Tu dois passer outre ces absurdités pour vivre ta vie. Mais c’est dur de décider de rester ici. Beaucoup de Grecs vont l’étranger, donc on a en plus cette excuse. Quand j’ai lancé Keep Shelly In Athens, je voulais être ici. J’ai toujours pensé que ce serait ma base, mais que je pourrais aussi travailler ailleurs. Donc je considère l’idée de démanger. Être à Londres, à Paris, ça rend tout accessible, tout plus proche.
J : De Grèce, tu ne peux pas voyager ailleurs en train. Tu es obligé de prendre l’avion. Ça faciliterait tout.
Tu ne penses pas que tu trahirais Athènes et les Athéniens ?
N : Absolument pas. Si j’étais Vangelis, je me sentirai obligé de rester. Mais là, ce serait fou de penser ça. On a des gens qui nous suivent, mais on n’est pas vraiment célèbres.
J : Même si on m’a reconnu dans l’avion la dernière fois ! Une femme qui était venue à un concert est venue me parler sur un Francfort – Athènes. Mais ça m’a surprise.
Comment c’était Kypseli quand vous étiez enfants ?
J : Tu pouvais courir dans la rue à cette époque et ne t’inquiéter de rien. Les parents laissaient leurs portes ouvertes tard la nuit sans s’inquiéter. Je n’imagine aucun parent laisser son enfant aller acheter de la glace au milieu de la nuit. Avant, ça se faisait.
N : Oui. Tu avais des gamins de 7 ans qui sortaient de la maison et revenaient pendant la nuit. On sortait sans les parents, aujourd’hui ce serait impossible. J’ai de très beaux souvenirs. On ne se souciait de rien. On jouait au foot dans la rue avec les autres gamins. Puis, les gens ont commencé à se focaliser sur le crime, à cause de la télé. Les médias ciblaient ces gens pour qu’ils en blâment d’autres. Tu connais le mécanisme.
La crise, ça a changé vos vies ?
N : Bien sûr. En 2010, juste avant que je fonde le groupe, j’ai été viré de mon boulot dans la finance. J’ai été la première victime de la crise ! Ils avaient 50 personnes et en ont viré 7. Je faisais déjà de la musique, mais on a galérait. Seul, j’ai donné naissance à Keep Shelly in Athens alors que je n’avais aucune certitude dans ma vie. Je ne connaissais personne dans la musique. Ni à Athènes, parce que je ne suis pas la personne la plus sociable, ni évidemment à l’étranger. Mais grâce à Internet, à des blogs aux États-Unis et au UK, j’ai lancé le groupe à le 15 juin 2010 et deux après j’étais à Coachella. C’était incroyable, surtout pour un groupe grec. C’est dur pour tout groupe non britannique ou américain. On n’en revenait pas. C’était fou d’être backstage avec Noel Gallagher, Feist ou Modelselktor alors qu’on avait seulement trois EPs. Même pas un album. Neon Indian nous a annoncé : « Maintenant on peut coashelly ». (rires)
Vous avez des amis qui galèrent encore ?
N : Oui, beaucoup. Beaucoup sont partis. Ils sont hautement diplômés et ont du partir. Tous ces créatifs doivent partir parce que ce pays ne peut pas les absorber.
J : Une connaissance étudiait pour devenir docteur. Il avait fini, mais c’était pendant la crise. Maintenant, il vend des fruits au marché…
Il y a des endroits que vous aimiez qui ont fermé ?
J : Il y a un restaurant de sushis qui me manque. En 2010, dans mon quartier, cinq magasins d’une rue se sont vidés puis ont fermés en quelques semaines. C’était étrange, ces locaux vident, les uns à côté des autres.
N : C’est surtout quand tu t’éloignes un peu du centre, comme ici, que c’est difficile. Tu as des bars hype qui ont ouverts sinon. Comme Six Dogs (un grand bar avec un jardin et des tables en bois récupéré dans le quartier de Psirri, ndlr). C’est sympa pour boire un verre, ça plait. Je ne pense pas que la crise les touche…

Aujourd’hui, vous vivez seulement grâce à votre musique ?
N : J’ai commencé à faire de l’argent il y a deux ans. C’était difficile. Pendant quatre ans, je cumulais les petits boulots : du commercial, je faisais les comptes de particuliers, je distribuais des tracts. Tout pour avoir un peu d’argent. À partir de 2014, j’ai pu totalement me concentrer. Mais n’imagine pas qu’on est riche. Ni même aisé. Jessica est également écrivain. Elle a des alternatives. Mais on va sortir notre disque nous même donc on prend 100% des décisions. Là, on va voir ce que ça donne.
C’est comment d’être une formation de musique électronique à l’étranger ?
N : C’est plus facile qu’être un groupe grec en Grèce ! C’était si rapide que je n’ai pas pu réaliser ce qu’il se passait. On a vu 57 villes. Jamais je n’aurais pu faire ça autrement. Parfois, ils ne savaient même pas qu’on était un groupe grec ! La première fois qu’on tournait aux États-Unis, les journaux faisaient référence à nous comme un groupe basé à Athènes, dans l’état de Géorgie. Ici, c’est au niveau des médias que c’est difficile. Niveau public je suis satisfait des retours. Déjà, les médias nous découvrent via des médias étrangers. Si tu n’es pas leur pote, ils ne vont pas te trouver. J’ai eu des critiques bien plus sévères ici qu’ailleurs. 70% était bon à l’étranger. Ici c’est l’inverse. Je ne savais pas comment trouver ni manager, ni dates. J’ai eu de la chance parce qu’ils sont venus à moi. Si tu as quelque chose d’intéressant à dire dans ta musique, ils viennent à toi.
Hier je visitais l’acropole et je pouvais entendre les mégaphones des manifestants en contrebas. C’est comment de vivre dans une ville si vieille, pour un artiste ?
N : Tu t’habitues à ça en vivant ici. Dans mon quartier, il y a des éléments qui datent du 11ème siècle. Je suis allé des tas de fois à l’Acropole. Avec des amis, avec l’école. C’était un point de référence il y a 2 500 ans et ça l’est toujours. Il y avait deux philosophies au siècle dernier : certains voulaient laisser ça comme une ruine, d’autre voulait rebâtir. Aujourd’hui, voir les ruines, ressentir une forme de tristesse, ça faisait parti du plan.
J : C’est assez symbolique qu’il y ait constamment tous ces échafaudages.
N : Oui. Mais on est en 2017. On respecte tout ça mais on vit ici, maintenant. On essaie d’avoir le son d’Athènes aujourd’hui. On parle d’aujourd’hui, notre musique est actuelle. Chaque petit élément, chaque courant musical ayant participé à cette ville est dans un coin de ma tête. Mais je n’y pense pas en écrivant. On essaie de transformer toute la négativité ambiante en positif. C’est la clef de l’art. Tu le prends et tu en fais quelque chose. C’est beau ou ça ne l’est pas. Le procédé, lui est toujours beau.