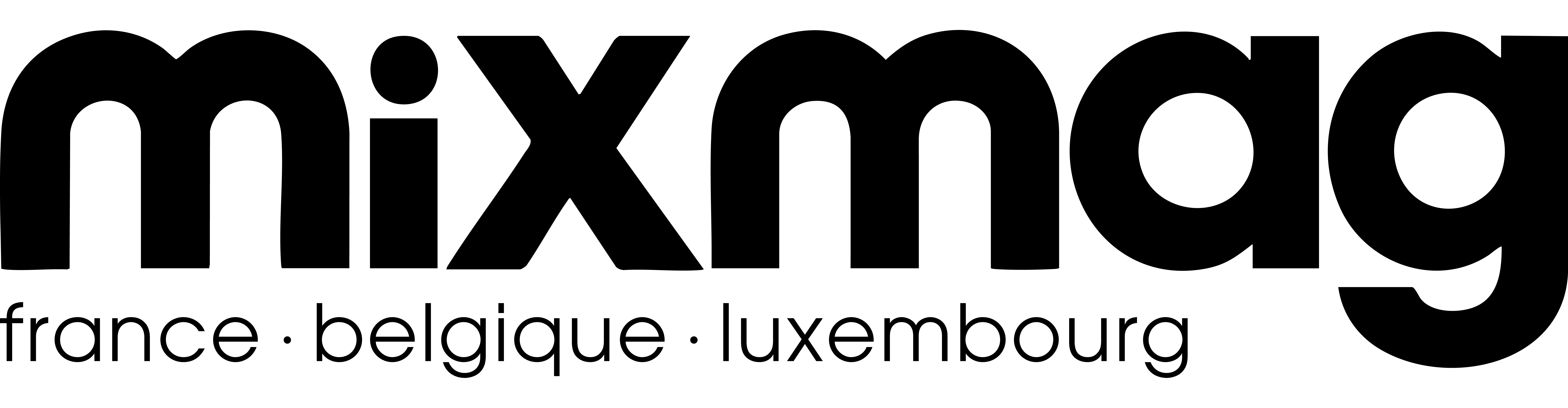Mag
Mag
La mystique techno de Raär
De Rouen à Tbilisi, la trajectoire d'une jeune étoile française qui s'exporte
Si vous cherchez Vital – plus connu son son alias de Raär – ce n’est plus à Rouen, ni à Paris que vous le trouverez mais dans la belle commune d’Ixelles, à quelques arrêts de tram du centre-ville de Bruxelles. De nature discrète, c’est dans un studio à l’abri des regards que le jeune artiste passe une grande partie de son temps libre. C’est en 2016, alors qu’il n’a que 20 ans, que Raär se révèle au-travers d’un banger incontestable : ‘Sometimes I Hear Sirens’. En pleine vague de house lo-fi, le Rouennais mettait un grand kick dans la fourmilière avec des pads surprenants de mélancolie et un sample vocal aussi charmant qu’inoubliable.
Exalté par un début de carrière fulgurant, Raär annonce la création de Vaerel, son propre label, dès l’année suivante. Déterminé à imposer son style et à se défaire des attentes des maisons de disques, il y publie quatre EPs dans lesquels l’artiste développe son style en toute liberté. Sa musique se durcit, se rapprochant de l’ambiance des raves suintantes. Maître de son projet, il s’intéresse également au visuel de ses disques et les fait communiquer intimement avec sa musique. Inspiré par l’ésotérisme, il s’appuie sur de vieux grimoires et sur la mystique du tarot pour concevoir des artworks en lien avec le titre et l’énergie de ses morceaux.
Saisi par le public techno du monde entier, Raär poursuit son ascension en tournant aux quatre coins du monde. Des warehouses de banlieue parisienne aux clubs mythiques de Berlin, c’est pourtant à Tbilisi qu’il trouvera ses scènes favorites. Toujours discret et introverti, Raär est de ces artistes qui ne vivent que pour leur musique et le partage avec le public. Alors qu’il se prépare pour une tournée en Asie et que Vaerel s’apprête à sortir sa première compilation – qui réunira Raär, Zadig, Quelza, AWB et Rhubarb - le jeune prodige nous reçoit dans son antre pour échanger quelques mots.

Salut Vital ! Peux-tu retracer ton parcours ?
Je viens de la campagne autour de Rouen. J’y ai passé mes plus jeunes années avant de déménager à Bruxelles, après l’obtention de mon Bac, pour suivre des études d’ingénieur du son. C’est là que je me suis familiarisé avec les studios d’enregistrement et les différentes machines que j’utilises pour produire ma musique. J’y suis resté trois ans avant de bouger à Paris pour me spécialiser en audio-production.
J’ai toujours été branché son mais je n’écoutais pas la même musique au lycée. C’était la phase Ed Banger, Kitsuné, Gesaffelstein… J’écoutais aussi un peu de rap et pas mal de labels indés mais je ne sortais pas beaucoup à l’époque : il n’y avait pas grand-chose autour de chez moi à part des bars. C’est en jouant de la guitare dans des groupes de rock indé que j’ai développé ma passion pour l’ingénierie du son.
Et c’est à l’école que tu as commencé à produire…
Oui, j’ai sorti mes premiers morceaux à l’âge de 20 ans alors que j’étudiais encore à Bruxelles. Ça a commencé avec un devoir. Notre professeur nous avait demandé de refaire un track de Prodigy. Il nous avait donné les samples en vrac que nous devions remettre en ordre. Au final, je n’ai pas vraiment fait le travail demandé. J’essayais plutôt de créer mon propre truc à partir du matériel fourni. C’est au-travers de mes études, dans le studio de mon école, que j’ai commencé à produire ma musique.
Qu’est-ce qui t’a poussé à produire ton premier morceau sous l’alias Raär ?
Un de mes amis de classe était vraiment à fond dans la techno, il ne vivait que pour ça. Ça m’a intrigué, je me demandais ce qui l’intéressait autant. Il m’a filé des playlists et j’ai tout de suite compris le truc. Ensuite, c’est allé super vite puisque l’un de mes trois premiers morceaux – ‘Sometimes I Hear Sirens’ - a dépassé le million de vues sur Youtube. Je n’ai jamais été un grand fêtard. J’étais sorti trois ou quatre fois à l’époque, au Fuse, mais c’est tout. Je l’ai produit dans le studio de l’école. J’ai tout de suite été habitué à bosser sur des machines sans utiliser les grilles ou les plug-ins d’Ableton Live. J’ai appuyé sur rec et j’ai enregistré mon morceau en multipiste, tout simplement. J’ai gardé cette habitude car, de cette manière, je peux me laisser porter par les machines sans trop réfléchir.
Comment as-tu pris le pli si vite ?
Je ne l’explique pas du tout… C’était une époque où ce genre de musique explosait sur YouTube, avec pas mal de tracks qui dépassaient le million de vues. Je pense que c’est un mélange d’algorithme, de chance et de travail évidemment. Je ne sors pas beaucoup mais j’écoute énormément de musique. Je laisse tourner des playlists chez moi toute la journée, c’est ça qui me guide et m’inspire.
Les chaînes comme HATE ou Perfect Circles sont-elles une opportunité pour les artistes de la scène techno ?
Aujourd’hui, je dirais que oui : c’est une bonne chose. Avant je n’aurais pas été aussi positif puisque ce sont elles qui récupéraient tout le fruit de mon travail. Maintenant que je bosse avec une boîte de distribution, j’arrive à faire valoir mes droits et récupérer un peu d’argent sur toutes ces vues. Ce n’est pas un revenu de dingue, ça tourne autour de 60 balles par mois mais je n’ai plus l’impression que mes tracks me soient dérobées.
Ton style a pas mal évolué depuis ‘Sometimes I Hear Sirens’. Quelle direction essaies-tu d’emprunter ?
Carrément, je suis assez content des morceaux que je m’apprête à sortir. Je continue sur la lancée de mes deux dernières sorties : beaucoup de modulaire, des ambiances atmosphériques et des rythmes plus déconstruits. Le modulaire me permet de surprendre davantage. Quand je réécoute ce que je sortais il y a trois ans, je ne suis pas toujours satisfait. Il y a même certains morceaux que je préférerais oublier. Aujourd’hui, je bosse sur des morceaux pour un VA sur un label allemand et un autre sur mon label, Vaerel. Mon prochain EP est déjà prêt, je suis impatient de le dévoiler courant 2020.

Donc Vaerel s’ouvre finalement à d’autres artistes…
Oui, ça m’a pris du temps. Je bosse sur ce VA depuis le mois de juin à vrai dire. Initialement, Vaerel devait me servir à asseoir mon style. C’est pour cela que j’ai commencé par ne sortir que mes quatre premiers EPs. J’aime tout contrôler : la musique, le visuel, la communication.
Tu avais l’impression d’être bridé en bossant avec d’autres labels ?
C’est ça… Encore aujourd’hui, lorsque je bosse avec d’autres labels, on me demande de changer ceci ou cela. Ce n’est pas mon genre, je préfère me rétracter et dire tant pis. Quand on enregistre tout en live comme je le fais, c’est difficile de modifier des détails. Les labels ont souvent une idée précise de la musique qu’ils veulent sortir et, selon moi, cela nuit à l’aspect expérimental que peut avoir la musique électronique ; tout devient un peu trop prévisible.
Tu es producteur mais aussi très connu comme DJ. Pour toi, c’est quoi le rôle du DJ ?
La réponse est différente pour chacun de nous. Pour moi il s’agit d’un rôle d’éducation. J’aime surprendre, ne pas balancer de la techno 4/4 pendant 3 heures mais plutôt développer un tas de rythmes différents. Je ne suis pas fan de l’idée de « raconter une histoire ». Selon moi, c’est une montée en puissance, une exploration d’atmosphères différentes. Je télécharge environ 1 giga de musiques par semaine et j’essaie de trier les morceaux en fonction de leur genre, de leur intensité ou de l’heure à laquelle j’aimerais les jouer. En ce moment je ne loupe pas une sortie du label Semantica REcords, de l’artiste Kronom. Je suis énormément Quelza, qui va d’ailleurs sortir un morceau sur mon label.
Tu pars bientôt en Asie, ça te fait quoi d’être écouté aussi loin ?
Je n’y crois pas, c’est complétement dingue. J’ai hâte de jouer en Corée car le club qui m’a booké est entièrement insonorisé. Le son doit être vraiment fou. Il me manque l’Australie et l’Afrique et j’aurais fait mon tour du monde, c’est une vraie chance. J’aime me retrouver seul, alors ce que je préfère dans mon métier ce sont les moments d’enregistrement en studio et ceux où je tourne.

Le public est-il le même partout ?
Absolument pas, la foule change énormément d’un pays à l’autre. Quand je regarde la scène actuelle, Berlin a perdu de sa superbe : ce n’est plus la capitale. Je ne sais pas si ce sont les clubs ou le public mais, si tu ne joues pas une techno banale, les gens ne dansent plus à Berlin. Paris prend elle aussi cette direction… c’est dommage. Les meilleures ambiances se trouvent aujourd’hui dans les pays de l’Est. Le public est curieux et sait s’amuser.
Comment te sens-tu aux platines ?
Quand je joue j’entre dans une sorte de transe. Cela n’arrive pas tout le temps mais quand ça vient, mon set devient meilleur. Je suis à fond dans les sons et ma manière de mixer s’affine. Je suis quelqu’un de très introverti, alors j’essaie de développer l’aspect introspectif de mes sets : créer un tunnel, une faille spatio-temporelle. Avec la polyrythmie, tu vois la transe se communiquer, la foule se synchroniser. C’est ce que je vise à chaque fois que je mixe.
Il y a des DJs qui t’inspirent niveau technique ?
Dax J, sans hésiter. J’ai posé un closing après lui il y a quelques semaines. J’ai pu observer sa façon de mixer pendant une demi-heure et j’ai tellement appris, c’était impressionnant. Il a une manière de mixer hyperactive avec énormément de rappels de boucles. Il connaît ses morceaux par cœur et prépare ses cues à l’avance, ça lui permet de lancer des drops à n’importe quel moment en appuyant sur un bouton. Ce sont des techniques que j’essaie de développer moi-même. Cette année, j’ai commencé à mixer avec une troisième CDJ pour avoir une dimension plus proche du live. Je peux superposer les couches, garder un kick et m’amuser plus que si j’enchaînais les tracks de manière linéaire.
Ton dernier souvenir marquant derrière les platines ?
Il y en a plusieurs, mais mes deux dates au club Bassiani de Tbilisi (Géorgie) m’ont vraiment marqué. C’est là que j’ai eu un déclic. Tu ne t’arrêtes pas pendant huit heures, tu peux jouer absolument tout ce que tu veux et le public reste toujours réceptif. C’est un club qui t’offre énormément de liberté, ce qui n’est pas le cas partout. Par exemple, j’ai été récemment booké pour des ‘acid-sets’. Les organisateurs me demandent de jouer de l’acid alors que ça n’a jamais vraiment été mon délire. Ça peut être marrant, mais c’est dommage de ne pas faire confiance au DJ. Néanmoins, les organisateurs ne sont pas toujours fautifs, je crois que le public aime (peut-être un peu trop) l’acid.
Thémis Belkhadra est contributeur pour Mixmag.