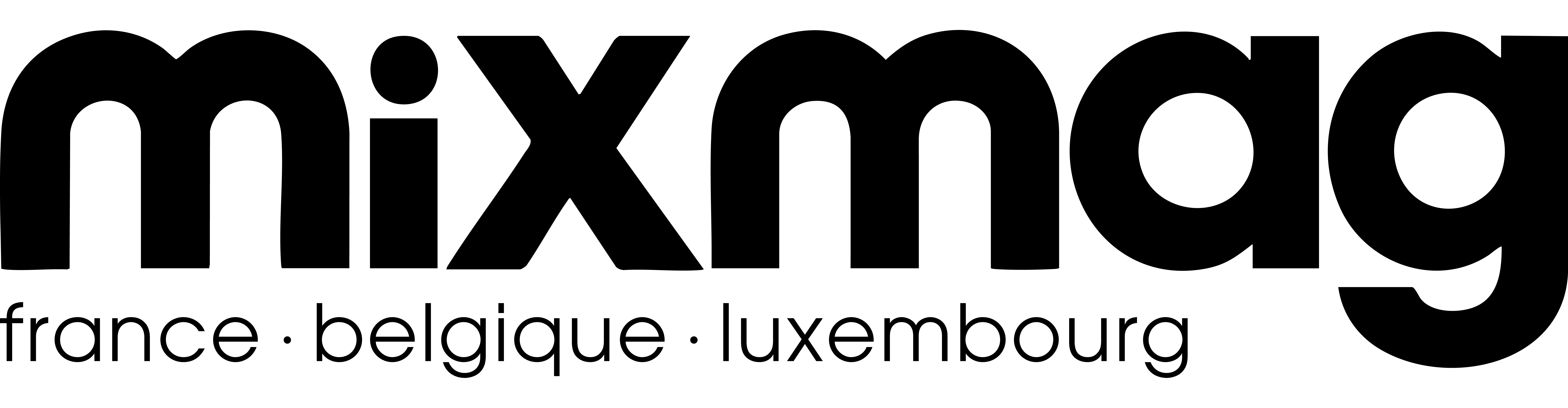Mag
Mag
On a testé pour vous : la rave matinale sans alcool à Paris
Immersion dans l'univers étrange et bariolé des "before" matinales
On sait ce que vous vous dites : mais qui peut-il avoir le courage, la force ou l’envie d’aller faire la fête avant d’aller bosser, de 6h à 9h du matin, et tout ça sans alcool ? C’est en tout cas le concept du collectif Daybreaker qui réveille Paris depuis un an et demi et officiait vendredi 29 septembre son dernier « before work » à Communion, sur le toit de la Cité de la Mode et du Design.
Cela faisait deux jours qu’avec Un Deux, le DJ français booké pour cette matinée festive, nous étions en pourparlers autour de cette épineuse question : yoga à 6h du matin ou pas ? Après avoir réalisé que le réveil allait donc sonner une heure plus tôt encore, notre témérité (ou notre héroïsme) a eu raison de nous et nous acceptions. Mais il fallait croire que les divinités de l’aube avaient d’autres plans pour nous deux. Le cours de yoga étant complet depuis des jours et nous fûmes contraints et forcés de dormir une heure supplémentaire. Quel dommage. Reste que, Paris, tu ne cesseras jamais d’impressionner par ta motivation sans faille. Et ce n’était qu’une première démonstration.

À 6h45, c’était une forêt de gambettes en leggings multicolores qui nous accueillait, ondulante au rythme du maître yogi dans une matinée encore opaque. Le tek de la terrasse de l’ancien Nuba était glissant d’humidité quand Un Deux, les yeux collés mais exalté de jouer sa house sur fond de lever de soleil, prit le contrôle des platines. Le temps de remarquer le buffet healthy du petit-déjeuner avec sa montagne de bananes et de commander un thé à l’Indien qui portait une guirlande lumineuse verte dans sa barbe blanche, les braves participants au yoga étaient déjà sur le dancefloor, parés de déguisements, d’accessoires festifs et de grands sourires.

Bientôt, un saxophoniste improvisant sur la house soulful d’Un Deux, un MC galvanisant la foule (quand il ne l’haranguait pas) et des breakdancers chaussés de LED shoes les rejoignaient.
Avec le flot constant de nouveaux participants aux fringues bigarrées et plus en forme qu’on ne l’avait imaginé, c’est doucement un mini Burning Man que l’on croirait voir s’organiser au bord de la Seine. Le soleil a montré ses premières couleurs autour des 7h20 et une poignée de minutes plus tard, l’ambiance rivalisait avec celle que l’on peut retrouver by night, les zombies d’after en moins. C’est bizarre quelque part mais les contours de ce moment finissent par se flouter facilement et on bascule dans « la fête » au sens large, celle dont nous sommes tous familiers, peu importe l’heure ou l’endroit.

Dans cette grande farandole de bonne humeur, de maquillage, de nourriture bio et de traces d’oreillers, on ne peut manquer de ressentir ce positivisme ambiant – un peu forcé – dont les États-Unis ont le secret et qui retapisse bon nombre de leurs événements musicaux, à commencer par le Burning Man. « Tout est possible », « vous pouvez y arriver, », « lancez-vous », c’est ça l’esprit « burner » que veut importer l’équipe française de Daybreaker, rencontrée quelques années plus tôt dans l’épicentre historique de la culture hippie, San Francisco.
Une certaine idée de la liberté, du bien-être et du dépassement de soi qui – on le sait – trouve un écho dans les préceptes en vogue des start-ups, très répandues dans la ville américaine. Ce n’est donc pas un hasard de constater qu’une majorité du public régulier de Daybreaker se dit entrepreneur (le report live du Parisien à l'appui).

Une fête finalement très « Macron-compatible » mais qui n’enlève rien à ses bienfaits : on nous jure que c’est un excellent moyen de gagner en efficacité au travail, « un truc pour soi avant d’aller bosser » nous vante Flora de l’organisation, aussi prof de yoga. Il semblerait que ce concept de « before work » nous fasse aller dans le bon sens en fin de compte. Puis, qui sait, à forcer les Français à être heureux, peut-être qu’ils finiront par le devenir ? Mais pas demain, c’est grasse mat’.
Crédits :
Texte : Sylvain Di Cristo
Photos : © Alexis Arragon