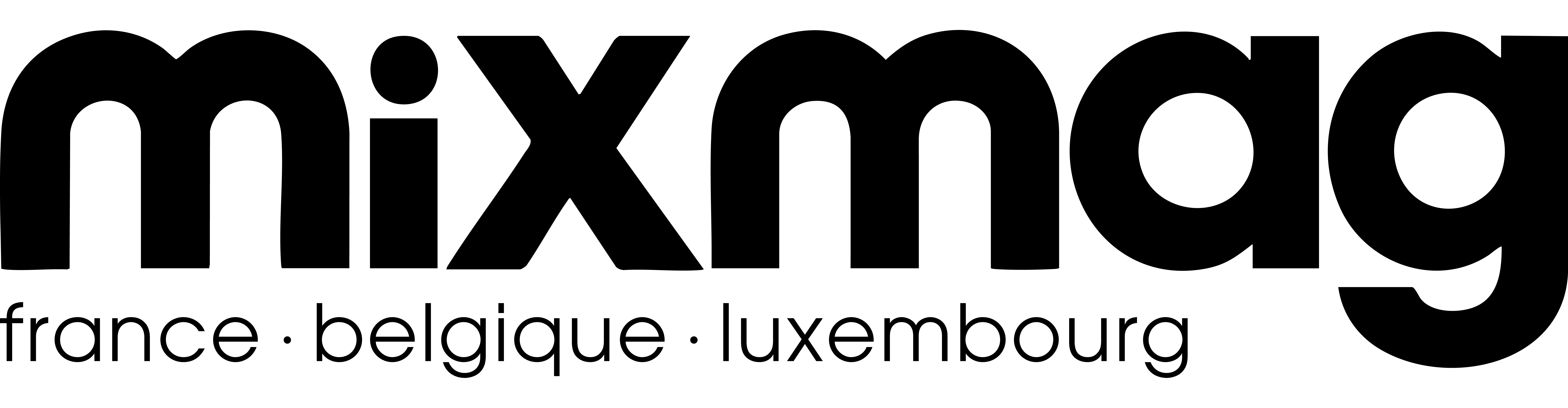Culture
Culture
Une scène électronique locale florissante a permis à Lisbonne de renouer avec ses banlieues
Paradis des artistes et les musiciens, Lisbonne et son son afro-portugais entrent une nouvelle ère
Le soleil de l’après-midi tape sur un kiosque (ou plutôt une petite case avec quelques chaises en plastique éparpillées) dans un jardin public près de l’avenue Ribeira Das Naus à Lisbonne, où un groupe de mecs en jeans et chemises criardes déchargent un sound system d’une camionnette blanche. Plus tard dans la soirée, une fête de 10 heures est programmée, un showcase de performances live et de DJs qui jouent différents styles issus de la diaspora africaine. Alors qu’on déballe un accordéon et qu'un guitariste assis sur un ampli accorde sa Fender, Wilson Vilares – la tête pensante du label Celeste Mariposa – se rend au comptoir et commande une bière. Pas loin de lui, une table de DJs et de producteurs du label Enchufada boivent quelques verres avant leur soirée Na Surra. Elle débutera un peu plus tard à B.Leze, un club dédié à la musique africaine.
Plus de dix ans après que le son de Lisbonne, marqué par un mélange d’influences angolaises et latines, ait fait ses premières vagues sur la scène internationale, la scène musicale de la ville connaît un nouvel essor. Des pionniers comme DJ Marfox et le groupe Buraka Som Sistema, dont les sorties explosives ont marqué le milieu des années 2000, ont ouvert la voie à toute une armée de jeunes producteurs et de musiciens professionnels. Ceux-ci ont repris le flambeau, en mêlant l’héritage des communautés de migrants avec les sons électroniques occidentaux de manière innovante. En première ligne, une poignée d’artistes qui se font une renommée internationale grâce à des titres expérimentaux qui exploitent les ficelles des genres comme le kuduro, la kizomba et le funanà.
Une de ces productrices est Nidia, une artiste qui a grandi dans le ghetto de Vale da Amoreira. Elle a commencé à poster des tracks sur SoundCloud quand elle avait 15 ans sous l’alias Nidia Minaj, un hommage à la rappeuse américaine. Unique femme signée sur Príncipe, le label basé à Lisbonne dédié à la scène issue des banlieues de Lisbonne, elle s’est faite une place sur la scène avec des beats poly-rythmiques et des loops qui vous prennent à revers. Son album de 2017, défiant les genres ‘Nídia é Má, Nídia é Fudida’ qu’on pourrait traduire par « Nidia est vilaine, Nidia est géniale », a figuré sur la liste des 20 meilleurs albums électroniques de Rolling Stone l’année de sa sortie. Nigga Fox, un autre pionnier de l’expérimentation rythmique qui, comme Nidia, a grandi dans un des ghettos de Lisbonne, a aussi rencontré un succès certain sur le circuit club international. Son EP Cranio sorti sur Warp en mars dernier a été encensé par la critique ; Aphex Twin l’a utilisé comme arme secrète dévastatrice de dancefloor dans ses sets.
Enchufada, le label fondé par les membres de Buraka Som Sistema en 2006 au son plus mélodique et affiné, a aussi poussé des artistes à l’avant-garde de la nouvelle vague électronique afro-portugaise. Parmi eux, l’étoile montante Pedro, anciennement connu sous l’alias Kking Kong, qui a collaboré avec le boss du label Branko sur le track funky et tribal 'MPTS', sorti en février dernier, un incontournable du label pendant l’été.

Vers 17h, la soirée Enchufada démarre. B.Leza est une petite salle nichée dans un immeuble de style industriel bordé d’une façade en verre, installé près d’une route qui longe la berge de la rivière. Cette salle de 300 personnes est déjà pleine à craquer quand Pedro passe derrière les platines. Après quelques années passées comme producteur de techno minimale, Pedro a découvert le premier EP de Buraka Som Sistema sorti en 2006 ; inspiré, il s'est mis dès lors à expérimenter avec les beats africains et latino. Au B.Leza, sa sélection donne le ton pour le reste de l’après-midi. Il enchaîne rapidement entre des morceaux qui réunissent des influences d’une myriade de genres des quatre continents, en y incorporant quelques unes de ses propres productions. Parmi celles-ci ‘Chibaria’, un titre afro-bass qui fait monter la température sur le dancefloor, et ‘Drenas’, un autre titre dancefloor entraînant avec une ligne de synthé planante et des rythmes complexes, similaires à ceux du kuduro.
Cette scène musicale en plein essor, ses loyers abordables et un climat agréable font de Lisbonne un foyer européen pour musiciens et DJs qui affluent des anciennes colonies portugaises et des traditionnelles capitales électroniques du monde occidental que sont Londres, Berlin, Paris et New York. Ce melting-pot d’influence, dans un port maritime ouvert sur le monde, anciennement au cœur de l’empire colonial du Portugal, ont ouvert de nombreux talents à des styles nouveaux.
Le producteur français iZem était de passage à Lisbonne en 2013, quand il a découvert une soirée batida, mutation du kuduro angolais né dans les banlieues pauvres de la ville. « J’entends parler de DJs qui emménagent ici tous les jours », il raconte. « Au début, je voulais rester une semaine ou deux, mais la scène était tout à fait unique. Cette approche hybride m’a complètement scotché – la manière dont les producteurs locaux font référence à la musique angolaise et brésilienne, tout en maintenant leurs racines dans les sons européens et américains ».
Depuis son emménagement à Lisbonne, iZem s’est inspiré des styles afro-brésiliens et angolais qui saturent la culture locale. Son EP ‘Beni Lane’, sorti sur Enchufada en juin, comprend quelques uns des tracks les plus frénétiques et dancefloor de sa carrière. Le lead single et ‘Frikii’, avec la voix du chanteur afro-futuriste irlando-sierra-léonais Fehdah, s’impose dans la progression de son set hypnotique, bourré de voix, qui rebondit entre des passages de bossa nova brésilienne et de hip hop américain.

Un peu plus tard, alors que le soleil se couche derrière l’énorme statue du Christ sur la rive opposée, Branko passe son edit de Badsista & Tap - ‘Na Madruga’, de sa compilation Na Zona sortie l’année précédente. Alors que la lumière dorée du soir filtre à travers la verrière du club, la foule en sueur commence à entonner sa mélodie de flûte reconnaissable. Quand la bassline explosive du morceau arrive enfin, un cercle se forme sur le dancefloor bondé. Au centre, un homme en chemise à motifs rouges et noirs, aux couleurs de l’Angola, enchaîne des mouvements de pop & lock aux côtés d’une danseuse experte en mini short blanc, qui se déhanche sur le rythme.
Pendant un moment, alors qu’ils dansent sur le beat hybride entre trap et baile-funk, la foule les acclame, avant de se refermer ; les voilà à nouveau entourés en danseurs. Alors que le set suit son cours, d’autres cercles se forment, de plus en plus nombreux quand le son se teinte d’influences gqom et de zouk caribéen. « C’est ça, le son de Lisbonne », nous confie l’homme à la chemise rouge et noire un peu plus tard, accoudé au bar. « Tu n’entends ça nulle part ailleurs ».
Une des conséquences notables de l’explosion du son afro-électro de Lisbonne est l’érosion des barrières sociales entre le centre-ville et les ghettos isolés de ses périphéries. Pendant plus de dix ans, DJ Marfox, un des pionniers du son batida, a eu du mal à trouver sa place sur les line-ups des clubs du centre-ville. « On associait ma musique à la pauvreté, aux gangs », il raconte lors de notre rencontre dans son quartier de Quinta do Mocho, à 30 minutes en voiture du centre de Lisbonne. C’est seulement en 2014, quand Príncipe a commencé sa résidence mensuelle à Music Box que des DJs comme lui ont commencé à se faire booker régulièrement en ville. « Maintenant, les DJs du ghetto passent des mois sur la route à jouer partout dans le monde en club et en festival. C’est un énorme changement », il explique.
L’attention internationale croissante sur les genres issus des ghettos de Lisbonne a aidé à redorer l’image des quartiers comme Quinta do Mocho, selon Marfox. « Les gens commencent à comprendre que le ghetto est un endroit comme un autre », il dit. En nous promenant dans le quartier, nous dépassons des habitants qui se détendent au coin des rues en sirotant une bière. D’autres vendent de la street food africaine sur le trottoir. Marfox pointe du doigt la grande peinture murale qui borde les blocs d’appartements : « Ce n’est que le début – mais les quartiers ont commencé à devenir symboles de créativité, et non seulement de choses négatives, comme la violence et la criminalité ».
À 22 heures, la soirée Enchufada se termine et la foule se répand à l’extérieur du B.Leza. De nombreux·ses fêtard·e·s retournent au kiosque, où la fête Celeste Mariposa bat son plein. Les chaises longues ont fait place aux danseurs, et Vilares transpire derrière les platines. Il joue un cocktail enivrant de funaná, genre venu du Cap-Vert, et de kuduro angolais des années 80 et 90, produit avec les moyens du bord. « On trouve plein de ces pépites qui tournent dans les quartiers populaires et les ghettos de Lisbonne », il raconte après son set. « C’est sur ce son qu’ont grandi les meilleurs producteurs d’aujourd'hui ». Après plusieurs heures passées à dévaliser les greniers et les collections de disques des quartiers, Vilares a choisi quelques titres pour Space Echo, une compilation sorti en 2016 sur Analogue Africa. Elle met en lumière la musique crée au Cap-Vert, après que les habitants aient retrouvé une cargaison de synthétiseurs dernier-cri échouée sur les plages en 1968.
Ce cargo, qui contenait des douzaines de produits fraîchement sortis des usines Moog et Korg, a été saisi par le gouvernement local et distribué dans différentes îles, où ils ont provoqué un vrai boom musical, une explosion de funk électro-cosmique. Selon Vilares, l’intégration croissante des ghettos de Lisbonne et le flux constant de musiciens qui s’établissent en ville devrait aider à propulser l'electronica afro-latine locale vers de nouveaux sommets dans les années qui viennent. « Les plus belles productions sortent souvent d’un mélange d’isolement, de technologie et de clash des cultures », il affirme. « C’était le cas dans les années 70 dans les îles du Cap-Vert – et c’est vrai aujourd’hui à Lisbonne ».
Will Crisp est journaliste freelance et contributeur régulier à Mixmag. Suivez-le sur Twitter.
Cet article est initialement paru sur mixmag.net. Adapté de l'Anglais par @MarieDapoigny