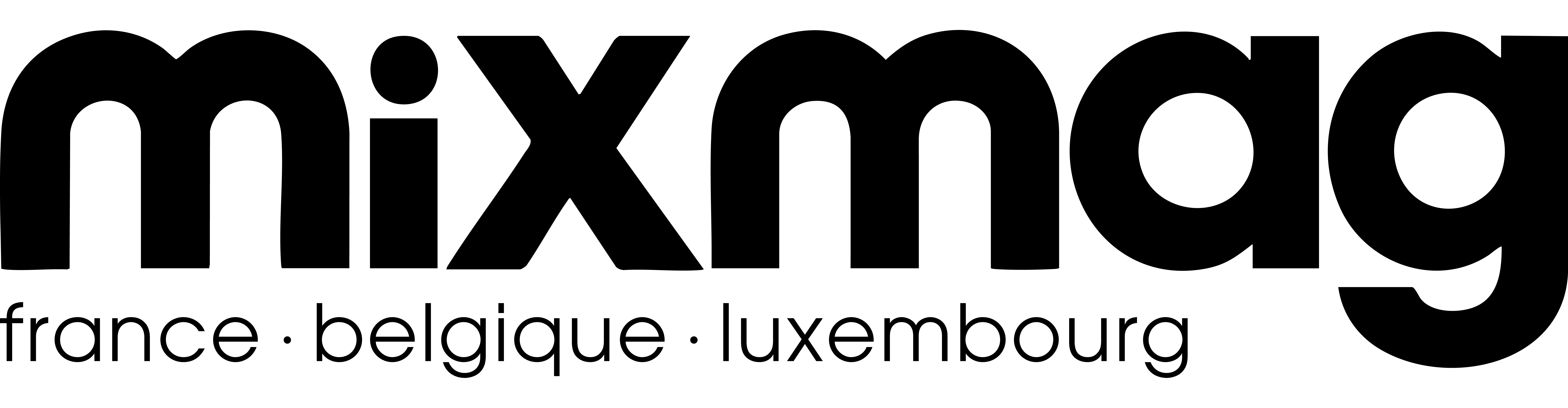Blog
Blog
Legalize Raving: De Téhéran à Beyrouth, Sina raconte la lutte des musiciens face à la censure
D'Iran au Liban, le cofondateur du crew parisien Subtyl retrace son voyage formateur
L'été, l'Iran se réveille une fois la nuit tombée. Il est 21h quand nous sortons, et la chaleur est écrasante. J'ai décidé de mettre en short, mes cousins me préviennent que je risque de me faire emmerder. Jouer avec les autorités est un sport national et je prends leur avertissement comme un challenge. Moins d'un quart d'heure après notre départ, un garde s'approche de moi. Mon cousin me chuchote de ne surtout pas parler Iranien et feindre l'innocence. Au début, le garde est courtois, me dit qu'il faut que je rentre chez moi rapidement m'habiller convenablement. En bref : pas de genoux ou d'épaule visibles, c'est la loi coranique.
Très vite le ton monte, mes cousins veulent me faire passer pour un touriste, le garde devient menaçant. Un autre garde arrive et des passants s'attroupent autour de moi. ‘il n’a rien fait de mal’, ‘son short est assez long’ : les locaux me défendent. J'ai 28 ans, ai vécu dans 4 pays différents et pour la première fois je comprends l'absurdité de ce qu'on appelle un état autoritaire.

Photo : © Mohamed Bourouissa
En 2016 j’ai décidé de partir chaque année un mois découvrir une scène artistique. Après le Portugal, je pars pour l’Iran. Le pays de mes parents, le pays de Persepolis ou Raving Iran, ce documentaire qui montre la scène rave illégale. Sur place, je n’ai que trois contacts dont un cousin pour m’aiguiller. Pas de blog, de site Internet, pas de “À Nous Téhéran” qui parle d’underground ou de soirées. Ici, la musique dansante est extrêmement contrôlée. Les titres pop sont tolérés, souvent grâce à des contacts bien placés. Pour les autres, il faut risquer le marché noir, et donc la prison.

Photo : © Raving Iran
Le soleil se lève sur la route de Chaloos, au Nord de Téhéran. Assis au chaud dans la voiture familiale d'Ehsan, trentenaire bossant dans les nouvelles technologies, j'écoute l'histoire de Reza. Guitariste depuis l’enfance, au look un peu hippie avec ses beaux cheveux noirs bouclés, ses pattes et sa chemise un peu ouverte qui laisse voir ses colliers. Mélomane, il se lance dans l'écriture d'un nouvel album. Mais pour ce passionné de folk iranien, la route est longue.
« Dès que tu chantes, tes textes sont passés au crible. » Il y évoque des choses de tous les jours, amours éphémères, galères financières, rien de subversif. « Mais pour le gouvernement, c'est pas assez lisse. » Son troisième disque vient de se faire refuser l’autorisation gouvernementale. « Sans ce papier, tu n'es rien. Tu ne peux pas sortir de disque, avoir de présence sur internet, ni donner de concerts. En gros, tu n'existes pas. » Entre colère et lassitude, sa voix ne perd rien en mélodie. Il traverse le calvaire parfait pour inspirer un "folk man", mais tôt ou tard pour lui, il faudra que ça cesse.

Photo : © Raving Iran, 2017
Je rentre à Téhéran le cœur lourd. Toutes les galères que j'ai pu connaître en tant qu'artiste me paraissent dérisoire par rapport au sort des artistes iraniens. J'ai de la peine, et en même temps une envie folle de créer, de profiter de cette liberté dont je comprends tout juste la valeur.
Je saisi mon ordinateur. J'ai l'habitude de toujours composer mes lignes de synthé en les jouant au clavier, pour garder un feeling humain. Ici je n'ai que les touches du clavier AZERTY. Assis sur le tapis de mon grand père, le casque sur les oreilles, je tapote ces trois lettres : Z H Q, Z H Q, Do Dièse, La, Do … La mélodie de ''Legalize Raving'' est là. En rentrant à Paris, mon ami Paul (de Polo et Pan) me prête son Juno 106 – un synthé classique idéal pour obtenir le son rave que je recherche. Je re-enregistre le morceau en me remémorant l’histoire de Reza.

Photo : © Sina
Quelques mois après ce voyage, je rencontre Mohammed Bourouissa à la SIRA où nous sommes tous les deux résidents. À l’époque, je passais parfois dans son atelier, lui dans mon studio. On se montrait nos travaux respectifs. Un soir, il organise un barbecue et je ne connais personne. À vrai dire, j’étais juste sorti du studio prendre l’air, et ça sentait la mergez grillée. Comment résister ?
Entre deux bouchées, on commence à discuter. Assis sur un banc en bois, dans la banlieue industrielle d’Asnières, il me parle de son projet au Liban pour la Biennale d’art. Il aimerait que je l’accompagne pour réaliser une compilation sur la place de la musique expérimentale dans la musique traditionnelle orientale. Je suis partant. Quelques semaines plus tard, Betty, son assistante à l’énergie rayonnante, m’envoie un mail. Elle a besoin de mon passeport pour réserver les billets d’avion.

« Si on peut mourir demain, alors pourquoi faire un truc qui n'a aucun sens ? »
Arrivé sur place, je me familiarise avec le reste de l’équipe constituée par Mohammed. Il y a Ghida Bahsoun. Elle travaille pour Ashkal Alwan. Sa courtoisie la fait paraître réservée au premier abord. Assis dans un bar à cocktails chic où les intellectuels se retrouvent, la glace se brise entre nous comme dans le shaker du barman. Intelligente, indépendante, déterminée, Ghida me raconte comment l'omniprésence de la guerre l'a motivée à ne faire que ce qu'elle aime.
« Si on peut mourir demain, alors pourquoi faire un truc qui n'a aucun sens ? Je n'ai pas peur de la galère. » Elle rêve d’un visa pour l'Europe, voire d'une résidence artistique. Derrière ses lunettes rondes façon John Lennon, ses yeux brillent. Avec le salaire moyen libanais, 500 euros, difficile de s'adonner à des passions artistiques, souvent coûteuses. Dans une économie mondialisée, le matériel nécessaire, l'ordinateur et les études ont souvent le même prix à Paris qu'à Beirut. Le pouvoir d'achat en moins.

Le centre d'art a mis un studio à ma disposition. De 10h à 16h, nous travaillons avec Mohammed sur la compilation. Il faut écouter des centaines de morceaux. Comme un DJ, je sélectionne d'abord tout ce qui sonne bien, tout ce qui me paraît original. Je ferais même découvrir des morceaux à Sharif Sehnaoui, notre boussole sur place et fondateur de l'excellent label Annihaya. C'est le soir, quand le centre se vide, que je me mets sur la production de mes morceaux.
Beyrouth est une ville en construction permanente. Les travaux, les bars et la circulation créent une atmosphère sonore chargée, presque saturée. Je commence à désigner mes sons de batterie et de basse à l'aide d'un modulaire. Il a la particularité de générer des sons très percussif et dissonant. Après deux soirées de bidouillages, je commence à avoir un groove qui me plaît. Pendant que le rythme joue, je frappe les notes de basse – comme sur une derbouka. L'idée est d'avoir du groove, ces petits décalages dans le rythme qui plaisent tant à notre cerveau qui trouve la perfection ennuyeuse.
Je fais écouter à Mohammed, qui se met à hocher de la tête. Mohammed est naturellement très expressif. Son visage peut contenir l'expression d'un enfant, d'un adulte et d'un sage dans la même discussion. Sa pensée est authentique et il ne ménage pas ses mots, deux qualités que j'apprécie profondément. Mais il est aussi très exigeant. Il me dit que ça claque mais qu'il y a « trop de notes ».
À son départ, je me relance. Cette seconde prise sera la bonne. Il est 23h quand je quitte le centre d'art. En face du bâtiment, un garage répare des grosses cylindrées américaines. Les mecs à Beyrouth sont du genre plutôt frimeur. Alors que les infrastructures du pays sont en ruine, ces jeunes Monsieur Muscle contractent des crédits sur 10 ans pour s'acheter des voitures de sport. Chacun ses objectifs. Quant à moi, j’y trouverai le titre de mon morceau: ‘Kingdom of Fake’.