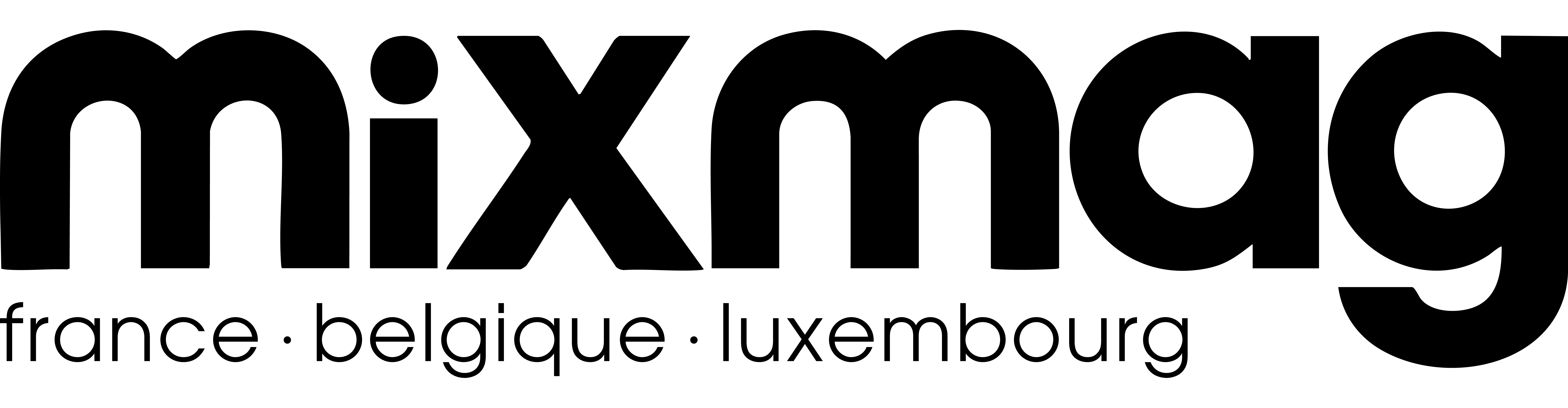Mag
Mag
Sina XX, du sens dans la fête
« La commercialisation de la fête lui a fait perdre ses valeurs essentielles »
Insatiablement créatif, mû par une profonde humanité et avec une recherche artistique au cœur de tout ce qu’il entreprend, Sina XX a repoussé les limites de l’expérience techno parisienne comme peu d’artistes et acteurs·rices de la nuit avant lui.
Un lundi soir pluvieux de septembre dans le parc du quartier animé du Temple à Paris, on attend Sina Araghi aka Sina XX, arrivé de Montreuil sur son scooter électrique. Sur un banc près de la grille, un vieil homme, parka grise et chapeau assorti vissé sur la tête, nous observe. Face à lui, un couple de jeunes est pris dans une conversation animée en espagnol, en se passant une bouteille de bière. Soudain Sina arrive, casque autour du bras, un grand sourire éclairant une barbe noire naissante surmontée de ses yeux noisettes pétillants.
C’est à Paris, sa ville de naissance, que le jeune producteur et organisateur s’est fait un nom sur la scène locale ces dix dernières années, passant en quelques années du statut de jeune DJ amateur à celui d’organisateur des soirées techno parmi les plus réputées de la capitale et de producteur prolifique repéré par AZF, qui l’a intégré à son collectif Qui Embrouille Qui. Ces dernières années il a signé une série de sorties sombres, mélancoliques et acérées, parfois teintées d’influences EBM comme sur son dernier EP Debts Will Tear Us Apart, ou empreintes de son ouverture et réflexion sur le monde sur Legalize Raving, produit sur la route entre Téhéran et Beyrouth. Autant de productions qui redéfinissent chacune à leur manière les contours de la techno française.

Né d’une famille perse, Sina a grandi en banlieue parisienne, dans le 93. C’est là, dans sa chambre d’ado, qu’il apprend à mixer, timidement d’abord, hésitant à s’aventurer devant un public. Après un premier coup de cœur électro à l’ère Beni Benassi vers l’âge de 12 ans avec Joachim Garraud et ses séries de podcasts, il suit avec attention la communauté Space Invaders, surfant sur l’ancêtre des réseaux sociaux Caramail, dinosaure des Interwebs que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Comme bon nombre de jeunes ados Parisien·ne·s, la Techno parade est un premier contact stimulant avec la fête. Une expérience euphorique, ponctuée d’un set de son idole de l’époque, Garraud. Mais le voilà confronté à un mur : impossible de partager sa passion avec son entourage du lycée dans le Val d’Oise, où on écoute plus volontiers les envolées lyriques de Limp Bizkit que celles d’Aphex Twin. Il décide alors d’explorer la nuit, mû par le désir de trouver un environnement à son image.
Le dancefloor du Batofar, institution des nuits parisiennes de l’époque, lui offre une première épiphanie. Dans la seconde moitié des années 2000, on y joue de la minimal tech, du BPitch, le label d’Ellen Allien : c’est l’arrivée de la minimale berlinoise en France. Il est immédiatement séduit par cette musique plus épurée, l’atmosphère sensuelle et la présence des communautés LGBT+ qui font de cette expérience « une vraie aventure de groupe ». Sur place, il rencontre un groupe de lesbiennes qui vont l’initier à la nuit parisienne. Il y découvre un microcosme de gens en marge, qui peinent à trouver leurs marques. Une réalisation : « J’avais toujours fait ces efforts - d’être sociable – en me travestissant. » Un lien indéfectible se forme dès lors entre son développement personnel et la culture festive.
Au soir des années 2000, Sina passe par une grosse période de découverte des clubs européens et parisiens de l’époque, comme la Java, la Bellevilloise :« à partir du moment où j’ai compris ce que c’était les clubs, je les ai tous essayés » Ceux des Champs Elysés, ceux du Sud de Paris, les clubs électro comme les clubs reggaeton… Sa curiosité le pousse à tout essayer pour faire ses choix. Immédiatement, il tombe amoureux de ceux dont la direction artistique est indépendante : La Java, le Social club. Le jeune passionné trouve ses marques dans la nuit, passe du statut intimidant d’outsider aux privilèges de l’habitué. Personne n’imagine encore alors que chez lui en secret, il produit du son.
À la fac en 2007, il fait la rencontre de Martin Munier, actuel D.A. du Sacré, ancien D.A. du Badaboum, qui va l’initier à la culture électronique, du point de vue du DJ cette fois. Martin lui partage sa culture de la techno minimale, la scène de Richie Hawtin,et du DJing, tout un univers en dehors des grands noms. Il apprend à mixer sur Traktor « J’avais un ordi, et un contrôleur de clochard – j’avais pas les moyens non plus pour un contrôleur, donc j’avais pris un clavier d’ordi, j’avais pété des touches pour en avoir que quelques unes, et sur le Q j’avais collé un petit patch en carton marqué ‘Play’, […] ‘Pause’, ‘Sync’» – le volume, c’était à la souris… C’était vraiment ‘DJ Débrouille’ ! »

Son échange universitaire en Pologne lui permet de mixer devant un public. Sa confiance en lui, grâce à la culture techno acquise à Paris, devient un avantage dans un pays où elle est encore peu représentée. Il y rencontre le directeur artistique d’un club qui lui propose de mixer la semaine suivante. « Je n’avais jamais mixé sur des platines, c’était catastrophique ! » Au bout de 30 minutes, on lui demande d’arrêter, le félicite de sa sélection et lui conseille d’apprendre à mixer. Il s’achète un contrôleur, rentre à Paris et après quelques dates mineures, devient résident des soirées Useless en les contactant sur MySpace. En parallèle, il monte les soirées dominicales tech house Zoo Club avec Martin. C’est là que se fera la rencontre de l’équipe de Jekyll & Hyde.
Si ses premiers sets font preuve d’un éclectisme certain – tech house, reggaeton, dubstep – il crée petit à petit son style, avant de l’affirmer au début des soirées avec Jekyll : techno. « On me reprochait souvent de jouer trop dur » : le style qui commence à émerger après la chute de la minimale est celui des Marcel Dettmann et du Berghain. La tendance est aux environs de 130 BPM, alors qu’il fait déjà monter le tempo bien au-delà. Jusqu’au moment où son collectif Subtyl commence à s’installer sur la scène parisienne, la scène ne lui offre pas la possibilité de déployer les ailes de sa sélection. « Aujourd’hui il y a moins de stigmatisation de la musique dure ». Mais les graines de son identité actuelle sont déjà bien présentes : un mélange de breaks, de new wave, minimal wave avec une affection particulière pour le renouveau synth pop et EBM.
En intégrant Jekyll & Hyde, il se met à mixer sur vinyle : « Le vinyle va me faire sortir de l’immédiateté de la musique électronique et me faire découvrir son histoire. » Une histoire difficile d’accès, cantonnée à l’univers des spécialistes. Face à cette multitude de choix, il affine son style, élabore une vraie identité. Il abandonne les styles comme la bass music, le dubstep et le reggaeton pour se concentrer exclusivement sur l’histoire de la techno. Un mot d’ordre : from wave to rave, soit la mouvance du milieu des années 80, les débuts de la musique électronique, de la new wave, des courants techno, rave et trance.
Ses recherches et sa connaissance pointue du genre le poussent dès lors à réévaluer son expérience de la scène locale. Après plusieurs années passées dans le cocon protecteur de la hype du clubbing, il réalise après ses voyages dans différents clubs européens que la nuit parisienne manque de sens et s’interroge sur le rôle de la fête. Traversant une phase d’introspection, il se retire du monde du travail, coupe les ponts avec ses amis pendant plusieurs mois, se concentre sur des lectures, l’écriture, touche à la pratique spirituelle pour la première fois. Et se pose une question : « Est-ce que la fête qui était aussi importante pour moi et les gens que je connais, les gens qui n’arrivent pas à trouver leur place dans leur famille, leur groupe social, ne pourrait pas aller plus loin ? Nous transmettre d’autres clefs ? Nous donner un espace ou on peut se sentir libres et s’exprimer pleinement ? Est-ce qu’on peut utiliser ce moment comme une plateforme d’expression pour le public également ? »
Avec trois ami·e·s, il commence ses recherches sur le situationnisme, l’art total, une partie de la philosophie des Lumières sur l’autodétermination, des études anthropologiques sur l’étude des rituels dans d’autres sociétés. Ces études les amènent à prendre conscience de l’importance sociale, individuelle et festive de la fête. Et une nouvelle réalisation : « La commercialisation de la fête lui a fait perdre ses valeurs essentielles ». De là, ils imaginent un événement contemporain rituel.
Des éléments clefs le frappent : la transmission de savoir et la catharsis, l’état de transe, l’utilité commune. C’est de cette manière qu’est venue l’idée de prendre possession d’un entrepôt, un lieu dépourvu d’identité et de vocation commerciale. La priorité est donnée aux artistes locaux afin de fédérer un public d’amoureux·ses de son. Le prix du plateau est divisé en deux : la moitié pour les performances artistiques (peintres, photographe argentique, artiste contemporain·e), l’autre pour le plateau.

De soirée en soirée, la communauté qui se forme autour du projet Subtyl est qualitative, se forme exclusivement sur du bouche à oreille. Ils se font les héritiers des soirées communautaires, sans le repli qui va avec : le collectif créé un endroit où les gens peuvent se sentir bien sans pour autant le définir comme « leur zone ». Un public varié se retrouve, les communautés se mélangent, issues du milieu techno, house, associatif, ou plus marginalisés, pour des soirées qui mélangent les genres, du hardcore au breaks en passant par le dubstep : « J’ai rencontré le directeur marketing de Chanel, au milieu d’un entrepôt dans une cité de Vitry ».
« Quand on faisait une scénographie ou une performance, c’est le public qui était concerné, ce n’est pas contemplatif. » Une des premières grandes réussites du collectif est construite autour d’une installation de lumières rouges d’Adrian Sierra Garcia, placée au centre du dancefloor. Une structure tentaculaire équipée de capteurs infrarouges dont les bras de LED s’illuminent selon le mouvement des corps, financée par la mairie de Paris à hauteur de 120,000€ et offerte gracieusement par l’artiste, fan du concept des soirées. L’ambition : détourner l’attention du DJ et la ramener au centre du public, qui se met naturellement à danser autour. « C’est là qu’on a compris que ce qu’on faisait était juste ».
Casser les codes de l’événement club devient une réalité : ils allaient peut-être bien pouvoir changer la manière dont les gens allaient et voudraient faire la fête. Autour d’eux, tout un mouvement s’active dans ce sens dans l’underground parisien : Jekyll & Hyde s’impose en précurseur, 75021 fait ses premiers pas et inspire le crew avec ses thématiques poussées, en mélangeant des sons qui ont alors peu de place dans les clubs.

« Je n’ai su que beaucoup plus tard que des gens avaient fait ce qu’on faisait il y a 20 ans, quand j’ai entendu parler de Rave Age », un label et collectif d’artistes pluridisciplinaires, musicien·ne·s et performers qui organisent des raves à la fin des années 80 avec Manu Casana. Sur le label, des pionniers méconnus qui organisent des raves folles, déguisées, des artistes qui sont là pour le public, la mise en avant de l’aspect communautaire de la fête. L’existence de ce passé, de cet héritage rassure. Quand sa première fête est annulée par la police, il comprend qu’il fallait trouver un lieu où il pouvait se passer de l’accord des autorités : Vitry.
De ces sept années passées avec Subtyl, Sina retire des leçons cruciales : l’action collaborative, porter un projet quand les autres ont des doutes. Qu’on peut faire les choses à sa sauce avec peu de moyens : « la force des idées et de la solidarité est beaucoup plus forte que celle de l’argent ». À l’ombre d’une scène club dominée par le paraître, la superficialité, sans aide du système existant et des institutions, une génération d’organisateurs irréductibles se fait une place avec un impératif qui renverse les codes : no backstage, no guestlist.
Il y a deux ans, avec l’arrivée des jeunes acteurs warehouse, un changement s’opère. Pour une nouvelle génération, la fête libre devient synonyme de défonce. L’arrivée du GHB à Paris, la montée des risques et le durcissement du marché de l’immobilier créent une atmosphère générale qui démotive l’équipe à trouver de nouveaux lieux et s’engager dans des procédures d’autorisations complexes pour leurs installations artistiques. Dans ce contexte morose apparaît une lueur d’espoir : l’aventure Megadestock.
Après des années d’itinérance, le collectif souhaite s’ancrer dans un lieu pour se l’approprier, inviter des artistes en résidence en semaine, les laisser créer des installations. En cherchant des entrepôts à louer, une opportunité : un petit entrepôt à taille humaine, sur le site d’un ancien supermarché dans un quartier industriel, pour 200 personnes. Le coup de cœur est immédiat : « On a signé, et on a ouvert trois semaines après ». Ils payent les 3 mois de loyer avec les économies de l’association pour enchaîner les événements et les collaborations artistiques et jeter ainsi les fondations d’un prochain lieu. Et vérifier par là si la vie de gestionnaire de lieu leur plaira. « J’ai compris à ce moment là que je ne voulais pas le faire. […] C’est un travail hyper prenant… Assurer la D.A. d’un lieu toutes les semaines, ce n’est pas du tout comme faire une soirée par mois. »

Manque de chance, pendant le live qu’il doit faire le jour de l’ouverture, sa carte son grille. Trois mois de chômage technique et de frustrations artistiques s’ensuivent : « Le destin m’a fait comprendre qu’il fallait que je fasse un choix. » À l’aube de ses 30 ans, entre la production et les affres administratives et financière de la gestion, il choisit la musique. Sa formule d’une fête inclusive, bienveillante, portée sur l’expression du dancefloor, a fait ses preuves.
Au sein de Subtyl, Sina XX a déployé ses ailes de DJ et musicien. Tous les éléments de la démarche, de l’identité du collectif s’infuse aujourd’hui dans l’art de ses membres. Avec le label actif depuis deux ans, il soutient les artistes invités aux soirées : « C’était un très bon laboratoire, j’y ai appris ce que c’était que de faire un label ». De cette expérience est née l’envie d’en fonder un nouveau, dès début 2020. En y intégrant une bonne partie des gens de Subtyl, mais avec une nouvelle identité et une démarche basée sur le crowdfunding. Une aventure collective, dédié aux collaborations artistiques, entre techno, transe, breaks, EMB. De son côté, l’aventure Subtyl se concentrera à nouveau sur ses événements réguliers.
Dans sa production, fort de sa connaissance des genres ingérés ces dix dernières années, le jeune Français parvient à développer un langage tout personnel au sein du paysage électronique, profitant d’une diversité parfois difficile à appréhender. Au fil des sorties, il approfondit sa démarche. « J’ai passé toute mon enfance à voir ces artistes et vouloir en être un, mais sans comprendre le chemin. Et là je vois que j’ai fait le chemin tranquillement, à ma sauce. » Tous ses morceaux sont ainsi composés en live : des idées sonores qu’il déploie, joue et enregistre sur le vif. « C’est toujours la première prise que je garde, c’est toujours la meilleure ». Sans idée et direction préconçue, il laisse libre cours à son inspiration, préférant le résultat de la création spontanée à la répétition. Une fois la composition faite, il revient quelques fois sur le mixage, écoute le morceau sur différents systèmes son et environnements et affine le travail sur plusieurs semaines.

En dépit d’une passion indéfectible pour la scène, son regard sur la nuit parisienne reste objectif. Sous sa forme actuelle, il en regrette les handicaps, sans pour autant nier son potentiel. « À Paris aujourd’hui, à part les lieux, on a tout : un public bouillant, des artistes hyper intéressants, une scène plus diverse qu’elle ne l’a jamais été, des gens de tous horizons et d’origines sociales différentes, ce qui n’était pas du tout le cas de la French touch par exemple ». Alors que son homologue allemande jouit d’une masse artistique énorme mais très segmentée, il apprécie la taille humaine de la scène parisienne, qui permet à des artistes d’horizons variés de se côtoyer et de collaborer.
Cette scène française qu’il aime, il la décrit également souffrante, étouffée par le manque de lieux et un ostracisme culturel envers la culture techno. « On a besoin de lieux pour fédérer, c’est la base d’une scène. Si on continue comme ça, dans deux ans, c’est mort. Ça peut aller très vite, ça disparaît. » D'une rencontre récente avec la maire de Paris, l’activiste retient une certaine exigence : la mairie veut aider les gens porteurs de projets. Et justement, selon lui, à un tournant économique et écologique décisif de l’histoire, les porteurs de projets communautaires doivent s’imposer : « Qu’on arrête de laisser des gens louches qui n’y comprennent rien à la communauté électronique et à l’hospitalité à la tête des lieux de fête ». Spectrum, Fusion Mes Couilles, 75021 : il s’épanouit au sein d’une génération qui a compris l’importance de l’entraide. Filons, coups de fils, dépannages – ces collectifs parisiens traversent les remous de la nuit ensemble, main dans la main.
En dépit de la solidarité qui fait la force de la scène actuelle, celle-ci souffre d’une bureaucratie extrêmement lourde et de normes punitives. « Aujourd’hui, la plupart des lieux disponibles sur le marché de la location ne seraient pas compatibles avec les normes d’accueil du public. » L’autorisation de la préfecture, condition sine qua none de l’ouverture des portes d’une soirée, lui semble aberrante : « C’est du jamais vu ! Pourquoi la préfecture serait celle qui donnerait l’autorisation à une entreprise d’avoir son activité ?! […] Pourquoi devrais-je avoir beaucoup plus de barrières pour réaliser mon souhait artistique et mes envies entrepreneuriales que toute autre entreprise en France ? »

Malgré les déboires et les imbroglios administratifs, et grâce à son engouement pour la scène et sa nature collaborative et passionnée, Sina s’est entouré de collectifs et de personnalités qui le soutiennent et l’inspirent au quotidien. À commencer par Qui Embrouille Qui, le collectif d’AZF et Pasteur Charles qui regroupe quelques unes des jeunes pousses les plus en vue du moment comme Myako, Nathan Zahef et Théo Muller: « Pour la première fois, j’ai rencontré quelqu’un (Audrey, AZF) avec qui je partage énormément de valeurs, un état d’esprit. Et voir quelqu’un qui avait réussi au niveau où elle a réussi en étant droite dans ses baskets, ça m’a redonné foi. Parce que pendant un moment, je me disais qu’avec la personnalité que j’ai, le succès n’était pas fait pour moi. » Un regain de motivation dans sa carrière qui lui donne l’envie de se dépasser.
Son prochain défi ? Mettre en lumière la culture spirituelle de la techno : il écrit un essai, qui verra peut-être le jour l’année prochaine. Une étude qui veut démontrer comment la techno a ses racines dans ce qu’on est en tant qu’êtres humains. Elle est construite autour de trois angles : la contreculture, les effets apaisants de la musique et ses effets physiques, physiologiques : « La musique techno est basée sur des rythmes tribaux qu’on retrouve sur tous les continents (…) ce n’est pas la musique de Detroit ou de Chicago, c’est la musique de l’Univers. Aujourd’hui cette universalité a encore plus de sens, à l’époque d’Internet, à l’époque de cette musique sans mots, sans drapeaux, sans nation, en plus à un moment où l’on fait face à des challenges qui vont devoir mobiliser l’humanité entière, notamment l’écologie. »
Citoyen du monde à la vision humaniste, Sina a trouvé une réponse aux espoirs de sa génération dans la communauté électronique, un milieu qui questionne désormais ses valeurs, comme la parité et la diversité, et s’est remise en quête de sens. Un moment particulier de l’histoire à laquelle il est fier de prendre part : « Je prends la chance qui m’a été donnée de faire partie de cette communauté comme un vrai honneur. » Son rêve : une fête sans privilège, où chacun·e ait sa chance. Un espace où genres, couleurs et nationalités cohabitent et célèbrent la musique, l’art et le vivre-ensemble: « J’ai toujours rêvé que la fête et la scène artistique soient à l’image de la société. » De ce partage naît une richesse qui surpasse les jeux de dupes et les copinages du passé. Et « tant pis pour les hommes blancs hétéros qui avaient tout gardé pour eux pendant des millénaires. » Pas mieux.