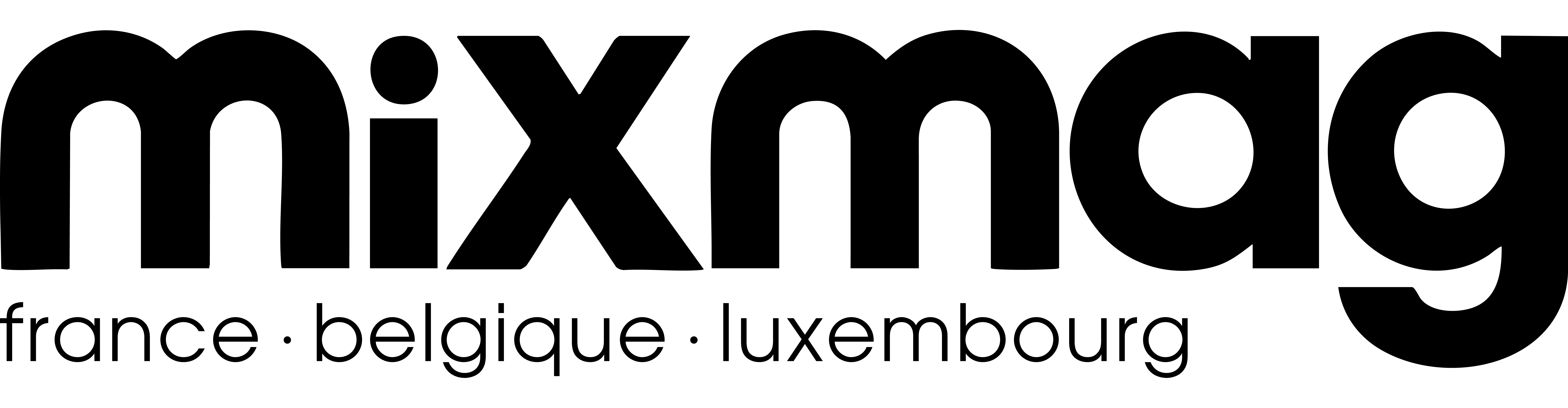Mag
Mag
Scène malsaine: Pourquoi les cachets exorbitants des DJs mettent en péril la scène électronique
Si la surenchère continue, beaucoup prédisent l’éclatement de la bulle électronique
Nous voilà face à une crise dans la culture club. Mais cette fois, l’ennemi n’est pas le gouvernement, les médias ou les promoteurs immobiliers. Les raisons de cette crise sont plurielles – mais sans brider la hausse incontrôlable des cachets des DJs, beaucoup prédisent l’éclatement de la bulle que connait en ce moment l’écosystème électronique, mettant en péril tous ses membres en dehors des plus grands DJs, événements et organisateurs d’événement.
Toutes les personnes interrogées s’accordent sur l’existence du problème. Mais les responsables désignés sont variés. Ben Rau, DJ, producteur et propriétaire de label berlinois, met en avant les 1% des DJs qui dominent la scène et se partagent « une part disproportionnée du gâteau ». D’autres, comme Dan Sumner de Pretty Pretty Good, pensent que les bookers sont souvent fautifs. Quand tant d’agents refusent de négocier les cachets des artistes, les promoters indépendant·e·s et les soirées plus modestes ont du mal à rentrer dans leurs frais. « L’organisation de soirée est ma passion mais c’est épuisant, stressant et impossible pour les orgas indépendants de pouvoir tirer un profit des soirées en l’état actuel des choses », il explique. Après quatre ans à sillonner des villes comme Bristol, Sheffield, Manchester et Leeds, Dan Sumner va mettre un terme à son activité. « Les coûts sont trop élevés pour pouvoir pérenniser les choses, mais le plus gros facteur en cause, ce sont les cachets des DJs »
Josh Doherty de Posthuman, qui gère le label et soirée I Love Acid, met en cause festivals et promoters « sponsorisés » aux gros budgets, capables de payer des cachets excessifs. « Ce qui fait monter les enchères à tous les niveaux – les agents attendent ce niveau de cachets de la part de tout le monde en conséquence ». Mais Andy Blackett, directeur de promotion de la fabric, ne veut pointer personne du doigt. « On s’est tous rendus complices de ça, de ce point où la scène en est arrivée, et on a atteint le point de rupture ».

Un paysage global en pleine évolution
Beaucoup de choses ont changé ces dix dernières années pour la musique électronique. La valeur de l’industrie est passée de 4 milliard de dollars en 2012 (la première année où une étude a été menée sur le sujet) à plus de 7 milliards en 2018, selon le rapport annuel d’IMS. La musique club est désormais le troisième genre le plus populaire au monde, avec une audience d’environ 1,5 milliards de personnes dans le monde. Les marques sont également impliquées, à l’heure où les DJs deviennent des ambassadeurs·rices de produits pour de grands noms, dont les ventes globales tirées par les artistes électroniques ont augmenté de 30% entre 2014 et 2016. La popularisation des vols à bas prix a permis aux DJs de parcourir le monde à la recherche de ces nouvelles audiences et des cachets qui vont avec. Tout ce développement, pense Rau, a donné lieu à la naissance du « DJ de niveau intermédiaire », qu’il décrit comme un phénomène nouveau. « les seules personnes qui tournaient il y a 10 ou 15 ans étaient les plus réputées », il explique.
À lire aussi : Le DJ booth dans l'histoire (1976-2016)
Il fût un temps, le DJing était vu comme un extra – un moyen d’arrondir ses fins de mois quand on gère un label ou organise des soirées. Mais le boom de l’ère EasyJet a ouvert un marché global, donnant lieu à une hausse générale des cachets. Tout à coup, un nombre important d’artistes de niveau intermédiaire, qui jouaient traditionnellement après le warm up et avant le headliner, se sont mis à voyager tous les weekends – certain·e·s atteignant ainsi un train de vie plus que confortable. Mais la baisse des revenus issus de la vente de disques et la disparition des autres sources de revenu a placé plus d’un·e de ces DJs dans une position précaire. Il faut jouer le plus de dates possible, ou alors choisir un autre parcours professionnel. Sauf qu'il y a un problème.

« Les bookings sont en baisse », explique Blackett. Et le nombre de clubs dans des pays leaders de la scène mondiale comme le Royaume-Uni a baissé de 21% en 2018, comparé à une baisse annuelle de 1% de 2013 à 2017. Sans compter les fermetures de clubs légendaires comme l’Output de New York, Heart à Miami et d’autres en Europe comme Concrete, le Batofar à Paris, le BAR de Rotterdam, l’Arena de Berlin et le Farbfernseher, sans mentionner le Kit Kat et le Griessmuehle, actuellement dans la tourmente.
Bien évidemment, les raisons pour lesquelles la plupart de ces clubs ferment sont variées. Mais les raisons évoquées – la hausse des loyers, la gentrification, la compétition avec les festivals et des évolutions sociétales comme la tendance « santé - bien-être » et l’explosion des applis de rencontre – sont directement liées aux difficultés auxquelles les organisateurs font face, en devant payer des cachets toujours plus élevés. « Chaque ticket devient plus difficile à vendre », dit Blackett. Et même quand le club est plein, il peut avoir du mal à atteindre le seuil de rentabilité, ce que certains artistes et agents peinent à comprendre. « Beaucoup d’agents débarquent dans ce milieu en pensant que leur artiste vaut plus à chaque date », il défend. « Ils vous disent, ‘On a fait sold out’. En fait, est-ce que tu as vraiment fait sold out ? Ou est-ce que c’est moi ? Parce que je peux te garantir que les budgets marketing de tout le monde ont été multipliés par deux ces deux dernières années. »
La culture du headliner
À Londres, les organisateurs·rices comme Blackett pointent également du doigt la saturation du marché comme responsable de ce revers. « Le truc est devenu un peu bateau », dit Blackett. « Cinq ans en arrière, il n’y avait pas beaucoup d’offre, ce qui profitait sans doute à fabric. Aujourd’hui il y a Printworks, Tobacco Dock, Krankbrother, Ibiza, la Croatie, un festival tous les weekends, et tout le monde utilise les mêmes artistes. C’est sursaturé. Plus rien ne sort du lot. »
Ben Rau et Eric Cloutier craignent que ces artistes de niveau intermédiaire ne deviennent une espèce en voie de disparition, alors que les organisateurs dépensent de plus en plus sur les headliners. Cloutier lui-même a récemment dû se résigner à prendre un job à mi-temps pour compléter son revenu et « combler les trous que l’étiolement de la scène électronique a laissé dans [s]a vie ». Mais à l’exemple de ce que Blackett décrit comme la « culture du headliner », il se sent, avec son associé, obligé de continuer à booker les DJs les plus populaires. « Parce que la culture du headliner est plus omniprésente, on va payer le headliner 80% du budget, puis booker des DJs locaux », il explique. « Mais ce qui est en train de se passer, c’est que les DJs intermédiaires, les “midliners” sont en train de disparaitre. Ça ne crée pas un milieu sain pour la scène. » Et sans cette réserve de midliners, Blackett se demande d’où vont pouvoir venir les headliners de demain.
Rachael Williams, programmatrice pour Rye Wax, salle alternative du quartier de Peckham à Londres, pense que ce basculement vers la culture du headliner – que l’on doit à l’accumulation des headliners les plus onéreux·ses pour ratisser un public plus large – est purement économique. Après une décennie de d’austérité et les coûts de la vie toujours plus importants, les gens ont besoin de tirer le maximum du moindre centime. « Le public cherche ces line-ups à rallonge, parce qu’il a l’impression d’en avoir plus pour son argent », explique Williams. Les petits promoters sont perdants, alors que les organisateurs les plus nantis qui sont capables de leur fournir ce supposé rapport qualité-prix occupent le haut du panier. « Les écarts se creusent, et les événements deviennent sue moins en moins accessibles », ajoute Williams. « Alors les plus petits organisateurs, ceux qui ont moins de moyens, ou les personnes racisées – celles et ceux qui n’ont pas le budget n’arrivent pas à se démarquer ». Ou iels jettent tout simplement l’éponge.
À l’heure où les organisateurs et clubs indépendants doivent fermer boutique sous la pression financière, les options de soirées à moindre coût disparaissent avec eux, laissant les jeunes fans faire face à une offre nocturne moins étoffée pour expérimenter de nouveaux sons. « On a parlé à des jeunes de 25 ans, en leur demandant comment iels dépensaient leur argent », dit Blackett. « iels ont dit qu’ils préféreraient dépenser 50€ pour aller à une grosse soirée avec 10 ou 12 noms qu’iels connaissent, plutôt que d’en dépenser 25 avec nous ou à Village Underground pour écouter de la musique dont iels ne sont pas encore sûr·e·s. Peut-être qu’iels y passeraient la soirée de leur vie, mais il y a une chance que ce ne soit pas le cas, donc iels préfèrent avoir l’impression d’un bon moment assuré. C’est l’effet de ce cycle de la culture du headliner, qui va être très difficile à casser, parce que le coût d’une sortie est si élevé. »
À lire aussi : Les line-ups à rallonge risquent de tuer l'atmosphère sur le dancefloor
Plusieurs raisons expliquent le coût important des soirées. Mais quand un seul headliner peut représenter 80% du budget d’un club pour un soir, cet argent doit bien venir de quelque part. Le prix des boissons est assez élevé à fabric, explique son programmateur, ce qui veut dire que le cachet du headliner doit être absorbé par les tickets d’entrée. « Avec le budget actuel consacré aux DJs, on ne peut pas faire baisser le prix d’entrée. » Ce qui met fabric et les clubs de son envergure en péril. Alors qu’un festival ou un club à la capacité de 5 000 personnes peut coûter deux ou trois fois le prix d’entrée d’un club de petite ou moyenne taille, si on n’en achète qu’une fois tous les quelques mois, le coût peut sembler plus abordable. Alors que la compétition fait rage, le monopole des gros événements et la perpétuation des gros cachets continue, inéluctablement.

Les deals d’exclusivité
Williams et Sumner disent qu’il serait plus simple pour les petits organisateurs de pouvoir booker les plus grands artistes si les clauses d’exclusivité pouvaient être levées. Les plus grosses salles peuvent facilement doubler les structures plus petites. « Mais en échange, les artistes signent des deals d’exclusivité jusqu’à six mois avant et après la date, ce qui techniquement les rend hors d’atteinte pour le restant de l’année », dit Sumner. Lui et Williams restent sceptiques quant au raisonnement derrière cette pratique de l'embargo. Après tout, le type de fêtard·e qui veut aller voir un·e DJ international·e dans un club de 200 personnes est souvent très différent de celui qui préfère les voir avec 5 ou 10 autres gros noms. « Ils protègent leurs intérêts, mais au détriment de la scène, même quand ce n’est pas nécessaire », regrette Sumner. Williams défend qu’annuler les clauses d’exclusivité permettrait aux plus petits organisateurs d’économiser sur les vols et les hôtels. Et puisque l’artiste et leur agent reçoivent toujours le gros cachet de la soirée de plus grande ampleur, jouer dans un club plus petit n’aurait pas d’impact négatif sur leurs finances.
En attendant, avoir affaire à des agents qui refusent de faire des compromis sur les cachets reste le plus gros challenge pour les orgas qui ont peu de moyens. « J’aimerais simplement qu’ils soient un peu plus compréhensifs, mais beaucoup ne le sont pas », dit Williams. « Ils veulent leur cachet, quoi qu’il en soit, et ce n’est tout simplement pas possible. Ça pousse des jeunes au bord de la faillite, et beaucoup d’organisateurs veulent quitter la musique. Ça perpétue cette situation qui fait que tout le niveau intermédiaire de la nuit est en train de s’effondrer »
Williams reconnaît que négocier le meilleur fee possible pour un artiste fait partie du travail de l’agent. Mais la position dans laquelle ils mettent les plus petits organisateurs est « démente » selon elle. « Si vous avez un club de 100 personnes, vous ne pouvez pas dépenser plus de 1000 € pour un artiste. Vous ne faites pas d’argent. Et c’est un problème auquel de nombreux organisateurs doivent faire face, où on les voit vraiment heureux quand ils arrivent à rentrer dans leurs frais – sans faire aucun profit pour tout le travail qu’ils ont fourni. C’est une situation sans queue ni tête. »

Une mentalité du tout-business
Certains agents essaient d’arranger les organisateurs. Keira Sinclair, cofondatrice de POLY. Artists avec Kim Oakley, dit que si un organisateur est incapable de payer le cachet habituel d’un artiste, elle leur demande d’en expliquer les raisons. « Ainsi, fournir un budget détailllé de leur chiffre d’affaire attendu et de leurs coûts afin de trouver un deal qui soit juste pour toutes les parties. » Cela-dit, elle précise que « juste » est un terme à prendre avec des pincettes. « On vit dans une société capitaliste, donc je pense qu’une bonne part de tout ça n’est pas juste. » Quand elle fixe un cachet avec les autres agents de POLY., il faut considérer certains facteurs comme la situation économique d’une ville, et le type de soirée. « On fait de notre mieux pour soutenir les événement alternatifs et engagés qui ne font pas ça pour l’argent, mais ont certainement un dessein politique ou d’autres objectifs. », elle dit.
Sumner pense également qu’il a eu de la chance de travailler avec certains artistes. « Beaucoup sont politiquement de gauche, et ils sentent qu’il est de leur devoir de prendre soin d’une scène qui paye leurs salaires », il dit. Même si la surenchère des cachets l’ont poussé à la faillite, « c’est pire dans d’autres scènes », il dit, en pointant du doigt la « techno-business » – un terme lancé par Shifted pour décrire le son monotone, big room qui a récemment vu sa popularité exploser. C’est aussi devenu un terme générique pour les artistes qui semblent privilégier l’argent sur la musique.
« La techno-business est bien installée, et ces artistes qui occupent le haut du panier et explosent n’ont visiblement aucun scrupules », il explique. « Et on ne peut pas vraiment leur en vouloir – si c’est la direction qu’ils veulent prendre, ce sont leurs priorités. Nous vivons dans un système capitaliste, c’est difficile de le leur reprocher. Mais c’est dommage, et ça fait a un impact négatif la scène. »
À lire aussi : Politique et musique électronique sont intrinsèquement liées, inutile de le nier
Sumner pense que cette mentalité du tout-business a porté un coup à la traditionnelle loyauté entre artiste et organisateur. Quand par le passé un organisateur prenait un risque avec un·e artiste peu connu·e qui explosait par la suite, l’organisateur se verrait récompensé avec des bookings plus abordables ensuite. Ce n’est désormais plus toujours le cas, incitant les plus petits organisateurs à prendre moins de risque, et les gros promoters davantage capables de booker les artistes les plus demandé·e·s une fois que leur hype et cachet atteint un certain niveau.
Les DJs et les agents ne demandent pas plus d’argent par malveillance. Et souvent, ce n’est même pas l’appât du gain qui est à l’origine de la flambée des prix. Les DJs doivent manger aussi, comme tout le monde. Et souvent, ils n’ont que 3 à 5 ans pour essayer de mettre leur carrière sur les rails. Pourquoi ne pas essayer d’engranger un maximum tant que ça dure ? Il n’y a pas de retraite dans ce milieu, et les artistes ressentent le besoin de préparer pour le tomber de rideau. Être DJ n’est pas un métier de tout repos, et souvent beaucoup moins lucratif et glamour que ce qu’il n’y paraît.
« De ce que je sais des gens que je connais qui ont du succès, iels sont au studio du lundi au vendredi à travailler sur leurs productions, des interviews, des podcasts, essayer de choisir ce qu’ils vont jouer, puis se retrouver sur la route deux ou trois jours pendant le weekend, et iels ne savent même pas combien de temps leur carrière va pouvoir durer », explique Sinclair. « Donc je peux comprendre d’où vient ce besoin pressant de ne faire que les meilleurs shows, pour construire leur carrière, et finalement ça se retrouve dans la demande de plus gros cachets ».
Ben Rau ajoute dans ce sens : « Même si on se sent très chanceux de pouvoir vivre de quelque chose qu’on aime, en vérité, un weekend avec trois ou quatre dates peut-être un vrai sacerdoce. » Il subsiste aussi une incertitude attaché au statut de DJ professionnel. « Tu ne te sens jamais vraiment en sécurité dans ce job », regrette Rau. « Tu n’es jamais à l’abri, financièrement ». Si les artistes au sommet ont peu de soucis à se faire, la situation est très différente pour celles et ceux qui essaient de se hisser à ce niveau.
Cette insécurité latente crée un climat de tension entre les agents, les artistes et leurs équipes, poussant vers l’obtention de fees plus élevés. « La source de revenu principale de la plupart des artistes vient désormais des bookings. Les agents n’ont jamais autant été sous pression pour obtenir ces dates », explique la bookeuse d’une grande agence, sous couvert d’anonymat. « Un artiste ou leur manager pourrait dire ‘il me faut plus de dates ce mois-ci, j’ai plein de factures à payer.’ On nous donne constamment des objectifs à atteindre. C’est très difficile, quand quelqu’un vous dit qu’il n’a pas assez d’argent pour vivre. » Les agents sont aussi sous pression pour obtenir les meilleurs deals possibles pour les artistes de leur roster, ou encourent le risque de les perdre au profit de quelqu’un qui le fera. « Il y a beaucoup de détournement de clients dans ce milieu. Il n’y a pas de contrats entre nous et les artistes », elle ajoute. Un autre agent anonyme ajoute : « Si vous n’obtenez pas ce qu’iels pensent mériter, les artistes ont le droit de choisir quelqu’un d’autre qui le fera. Le travail d’un agent est de prendre des décisions qui profiteront à leurs clients sur le long terme. »
Et quand bien même un artiste gagne ce qui semble un montant plutôt enviable sur le papier, ce qu’iels touchent vraiment à la fin peut s’avérer une somme considérablement moins impressionnante. « Avant que l’artiste ne touche le moindre centime, l’agent prend 15%, le management prend 20% – ça fait déjà 35% de moins, » dit Ben Rau. Puis il y a ce qu’on appelle les “landed deals”. Ce type d’arrangement implique que l’artiste doit s’occuper de payer son transport avec le cachet conclu. Mais parce que les shows ne sont souvent pas bookés au même moment, les vols à la dernière minute, les changements d’itinéraire mènent souvent à des pertes financières importantes. Pourtant ces deals sont monnaie courante dans une industrie où les organisateurs tentent de trouver de nouvelles manières d’économiser de l’argent, alors qu’ils doivent investir de plus en plus dans les headliners. « Attention, les headliners méritent bien d’être payés pour ce qu’ils font, parce qu’ils sont l’attraction principale », dit Rau. « Mais quand cela doit se faire au prix de line-ups plus variés, on étouffe la créativité et on empêche les nouveaux DJs de progresser dans leur carrière. »
Pour Eric Cloutier, la mentalité qu’il voit à l’œuvre en ce moment est source d’inquiétude. « Si quelqu’un se fait payer 45 000€ pour un set de deux heures, qui gagne vraiment au change ? » il demande. Les organisateurs basent désormais leur budget autour des cachets d’artistes, au détriment d’autres éléments essentiels qui rendent une soirée exceptionnelle – comme la qualité du son.
À lire aussi : Organisateurs, offrez-nous des fêtes, pas des soirées club
Alors que Sinclair minimise la situation, expliquant que « les meilleures soirées sont celles où le line-up importe peu », elle reconnaît également que « c’est de toute évidence un problème si de manière générale les promoters ne sont pas capables de prendre des décisions créatives parce qu’iels doivent penser avant-tout aux finances. » Alors quelles sont les solutions ?
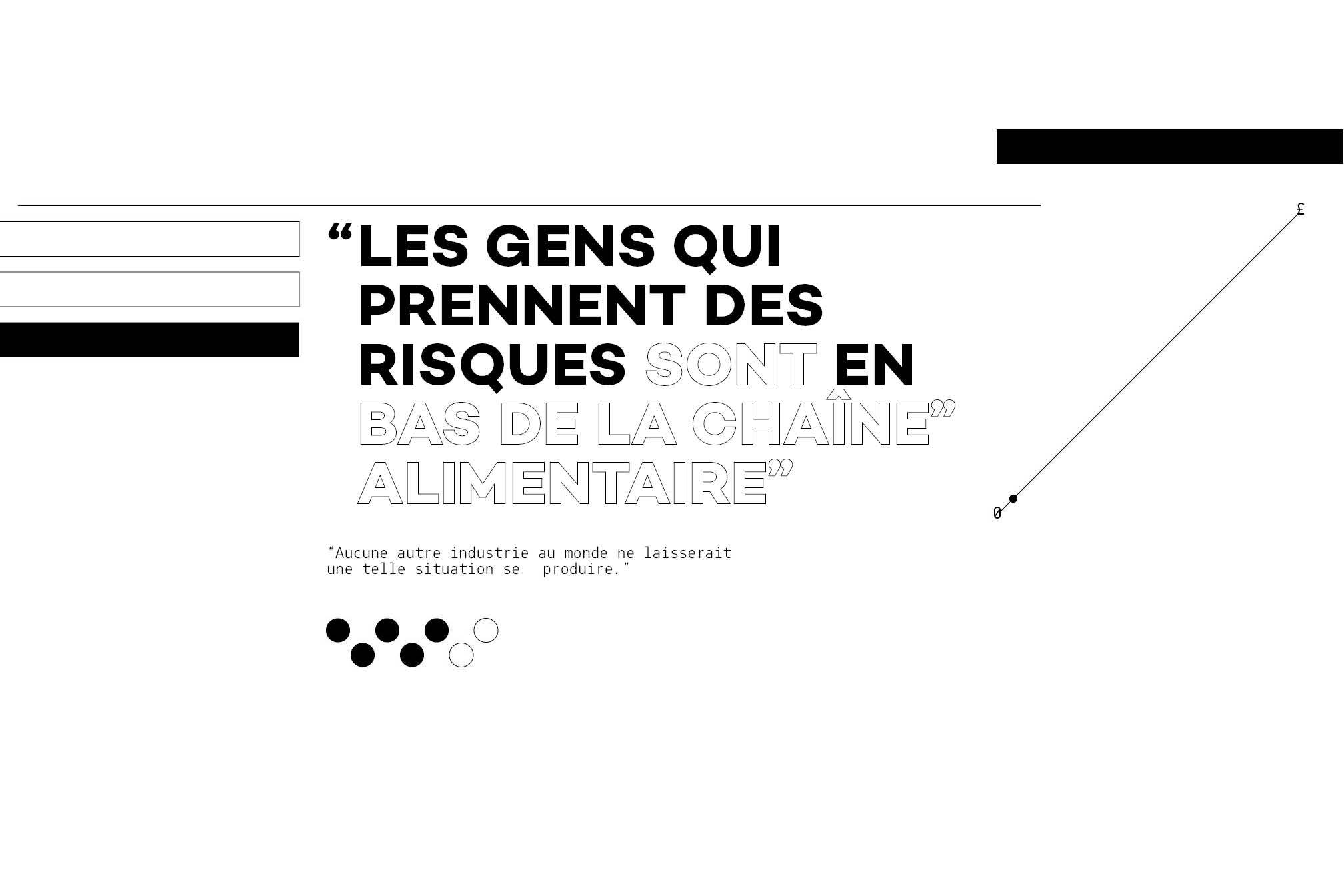
Partager les risques et les bénéfices
Établir une échelle de rémunération variable : une des réponses les plus simples et évidentes. Si un “cachet fixe” peut être utile pour déterminer la valeur d’un·e artiste, les agents doivent faire preuve de davantage de flexibilité en travaillant avec les promoters, permettant à leurs artistes de jouer dans des lieux plus petits, pour des cachets plus justes. Les artistes devraient également être davantage proactifs dans le processus de détermination du fee adapté à chaque offre qui leur est présentée. « Je sais que les DJs ne savent pas ce qu’il se passe du côté de leur agent », dit Cloutier, qui organise une petite soirée mensuelle au Paloma Bar de Berlin. « Iels se rendent compte que j’essaie de les booker alors qu’iels n’en ont jamais entendu parler. Leur agent décline l’offre immédiatement. » Mais certains DJs, il dit, devraient simplement « redescendre sur terre ». « Les sommes qu’iels demandent ne servent personne, à part les gens qui travaillent pour eux. Les agents et les managers sont ceux qui se font le plus d’argent en ce moment. »
Un booker anonyme défend que les DJs méritent leurs cachets. « Si les DJs reçoivent des cachets exorbitants, dans la plupart des cas c’est parce qu’ils ramènent énormément de monde, donc de l’argent, aux organisateurs pour lesquels ils jouent », il explique. Mais quand les soirées ne produisent pas les résultats escomptés, ils devraient également prendre en charge une partie des pertes. « Dans quel autre secteur commercial la personne prend en charge 100% des risques, met 100% de l’investissement sur la table et 100% de l’argent pour payer l’agent, le manager et l’artiste tout en restant tout en bas de l'échelle ? », s’interroge Blackett. « Personne n’imaginerait qu’une chose pareille puisse se produire dans aucune autre industrie ».
À fabric, la solution imaginée par Blackett est de changer le cachet de l’artiste en fonction de la fréquentation du club. Si le fee du DJ est d’ordinaire fixé à 8 000€, fabric lui offre 5 000€ à la place. Si le club est sold out, l’artiste obtient 12 000€. Si la soirée fait un flop, le club fait une économie de 4 000€, et l’artiste repart quand même avec ses 5 000€. « Ça arrive à tout le monde d’avoir une mauvaise date », dit Blackett. « Mais j’entends beaucoup d’organisateurs me dire qu’iels ont payé quelqu’un les 8 000 demandés, ont perdu énormément d’argent, et ne bookent plus jamais l’artiste. Ce n’est pas sain. Si l’artiste avait pris en charge une partie des responsabilité en aidant l’organisateur à diminuer sa part de risque, je suis certain que davantage d’organisateurs partageraient les fruits de leur travail quand les retombées positives arrivent. » Il faut admettre qu’il peut être difficile de mesurer d’où vient le succès d’une soirée, en particulier dans un lieu à plusieurs salles, comme fabric. Mais c’est pourquoi une communication honnête est la solution cruciale à ce problème complexe.

Ouvrir le dialogue
Les organisateurs devraient discuter entre eux, explique Blackett, et faire front face aux agents qui tentent de les faire jouer en concurrence pour faire monter les prix. Un phénomène déjà existant à Londres. « Nous sommes peut-être en concurrence, mais on se dit tous quelles étaient les recettes du bar, combien de tickets on a vendu, combien était le cachet, parce qu’on en a eu marre qu’on nous monte les uns contre les autres. » Il faut également installer un dialogue de confiance avec les agents, et admettre quand les ventes d’un show ne se portent pas bien. « Je pense que beaucoup d’organisateurs·rices ont été trop fier·e·s pour admettre que leur show ne fait pas sold out et iels ne le disent pas à l’agent ou au manager », affirme Blackett. Faire preuve d’honnêteté rendra les échanges plus faciles avec l’agent pour négocier son cachet sur une prochaine date.
Mais surtout, les agents et les organisateurs devraient commencer à discuter entre eux. « Il faut un dialogue de meilleure qualité », explique Sinclair. « Les gens doivent comprendre l’importance et l’extrême dévotion de l’agent, parce que les organisateurs s’adressent aux agents et ne font que parler d’argent. On parle d’argent aux artistes peut-être 5% du temps. Les 95% restants, il s’agit de s’impliquer dans leur carrière, d’entretenir un lien fort avec leur vie et ce qu’iels veulent accomplir avec leur art. »
Et cette mentalité antagoniste entre agents et organisateurs ne sert personne. « On monte les agents et les promoteurs les uns contre les autres, et c’est vraiment triste », déplore Sinclair. « Notre relation première est avec l’artiste, parce qu’on leur parle à longueur de journée, tous les jours. Mais les organisateurs sont l’autre coin essentiel de ce triangle, or on dirait que les agents sont montés contre les orgas, comme si on était là pour se battre. »

Limiter la marchandisation
Il est clair qu’en l’absence d’évolution du status quo, il est probable que le ciel s’assombrisse pour la scène électronique. Blackett prédit un « effondrement total ». Sumner est d’accord. « De toute évidence la musique électronique est devenue une valeur marchande, de gros intérêts financiers sont en jeu et il y a de la demande, donc je comprends pourquoi elle a autant grossi ces dernières années. Mais on a perdu le contrôle. Et si les choses continuent comme ça, la bulle va éclater. De plus en plus de petits clubs vont fermer. De plus en plus de petits organisateurs vont devoir mettre fin à leur activité, et l’horizon sera bien différent. »
Sans clubs, les agents et leurs artistes devront baisser leurs cachets de manière drastique dans tous les cas, alors qu’une source de revenu importante tarit et retourne à l’underground. « L’underground pourra prospérer de nouveau », pense Blackettt. « Je pense qu’on est allé un peu loin vers le marché de masse, et ce n’était pas l’essence de la culture électronique underground ».
L’idée d’un retour aux racines underground de la musique électronique peut sembler séduisant. Mais les dommages infligés à l’écosystème complet de la musique électronique par des cachets d’artistes excessifs, des clauses d’exclusivité superflues et abusives, la culture du headliner pourraient mettre des années à se résorber. Sans prendre soin d’évaluer les effets de nos actions sur la communauté dans son ensemble, sans communiquer honnêtement les uns avec les autres sur ce qui fonctionne le mieux pour tout le monde, ce cycle inégalitaire sans fin continuera de favoriser quelques uns au détriment de presque tout le monde. « Le plus triste, c’est qu’on dépend des petites soirées et des scènes locales pour que les DJs de talent se fassent repérer », dit Sumner. « Alors qu’on se dirige vers l’ère des gros festivals, des line-ups à rallonge et des superclubs, la ‘machine’ devient de plus en plus dépendante des réseaux sociaux et des relations publiques, donc la marchandisation ne va faire que s’accélérer. Et vous n’aurez plus ces belles histoires de DJs qui ont construit leur carrière dans des conditions qui sortent de l’ordinaire. »
Chandler Shortlidge est journaliste freelance, suivez-le sur Twitter et sur son site officiel.
Initialement paru sur mixmag.net. Traduit de l'Anglais par @MarieDapoigny